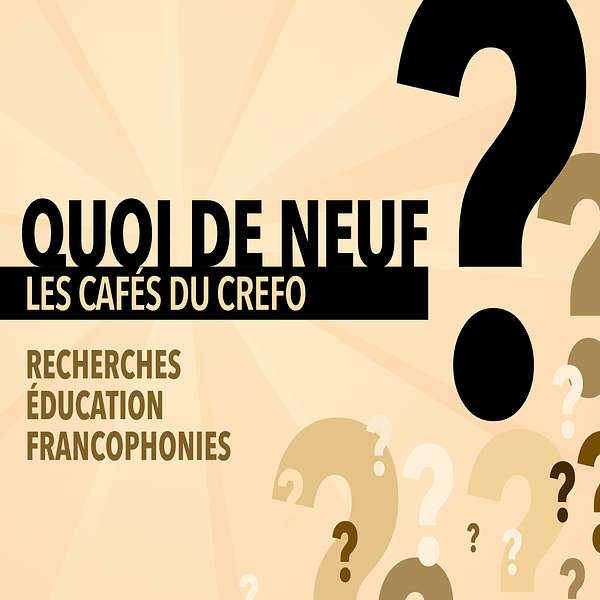
Quoi de neuf ?
Quoi de neuf ?
Favoriser l’inclusion en éducation : Entretien avec Rola Koubeissy
Dans cet épisode, Emmanuelle Le Pichon, directrice du CREFO, rencontre Rola Koubeissy, professeure adjointe au département de psychopédagogie et d’andragogie à l’Université de Montréal.
Rola Koubeissy est professeure adjointe au département de psychopédagogie et d’andragogie à l’Université de Montréal. Elle est spécialiste des processus d’enseignement et d’apprentissage en contexte de diversité et d’inclusion. Sa programmation de recherche se décline en quatre axes qui visent le développement professionnel des enseignantes et des enseignants et la réussite éducative des élèves. Le premier axe vise à comprendre et à analyser les perceptions des enseignants et leurs pratiques en contexte d’inclusion et de diversité dans des classes ordinaires ou d’accueil. Le deuxième axe vise à comprendre et à analyser le processus d’apprentissage et l’expérience socioscolaire des élèves, dont ceux issus de l’immigration et réfugiés, en contexte de diversité et d’inclusion dans des classes ordinaires ou d’accueil. Le troisième axe complète les deux autres; il porte sur les différents enjeux liés à la diversité et à l’inclusion et leurs effets sur les pratiques des enseignants et sur l’expérience socioscolaire des élèves. Le quatrième axe s’attarde au processus d’enseignement et d'apprentissage en contexte de crise ou en situation d’urgence. Pour les quatre axes, elle privilégie, entre autres, des approches critiques qui affirment, d’une part, le rôle des enseignants comme participants dans le développement des pratiques inclusives et interculturelles à travers un processus de prise de conscience critique et, d’autre part, les voix des élèves et leurs rôles dans le processus de construction de leur propre expérience socioscolaire.
Joey [00:00:00] Dans cet épisode, Emmanuelle Le Pichon, membre du CREFO, rencontre Rola Koubeissy, professeure adjointe à l'Université de Montréal.
Rola [00:00:07] Peut-être il y a certains enseignants qui résistent au changement ou bien qui ont peur du changement, mais d'autres ont la volonté de changer. Mais le système parfois les ralentit ou bien les freinent.
Joey [00:00:19] Bienvenue à Quoi de neuf?
Emmanuelle [00:00:35] Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre encore aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast du CREFO intitulé Quoi de neuf? Aujourd'hui, j'accueille la professeure Rola Koubeissy. Alors bonjour Rola!
Rola [00:00:51] Bonjour. Bonjour Emmanuelle. Bonjour tout le monde.
Emmanuelle [00:00:54] Alors Rola, tu es professeure adjointe au Département de psychopédagogie et d'andragogie à l'Université de Montréal. Tu es spécialiste des processus d'enseignement et d'apprentissage en contexte de diversité et d'inclusion. Ta recherche s'articule autour de quatre axes qui visent le développement professionnel des enseignants et, bien sûr, la réussite éducative des élèves. Alors, le premier axe concerne les perceptions et pratiques des enseignants en contexte d'inclusion et de diversité. Le deuxième, l'exploration de l'apprentissage et de l'expérience socio-scolaire des élèves, notamment des élèves issus de l'immigration et/ou réfugiés. Et puis une troisième perspective qui t'a amenée à examiner les enjeux de la diversité et de l'inclusion et leurs effets sur les pratiques enseignantes et l'expérience des élèves. Et enfin, un quatrième axe qui se concentre sur l'enseignement et l'apprentissage en situation de crise et d'urgence. Ton approche est critique. Elle vise à la valorisation du rôle des enseignants dans le développement de pratiques inclusives interculturelles et à mettre en valeur les voix des élèves dans la construction de leur expérience socio-scolaire. Alors tu vas nous parler de tout ça et je me réjouis d'entamer cette conversation. Mais c'est souvent une question que je pose parce qu'elle est à mon avis fondamentale, je voudrais bien que tu nous parles de toi. Non pas la biographie que je viens de lire, mais plutôt ton parcours de vie. Comment est-ce que ce parcours a influencé ton choix de t'orienter vers des processus d'enseignement et d'apprentissage en contexte de diversité et d'inclusion? Alors, on entend peut-être un chant dans ta manière de parler qui indique des origines d'ailleurs?
Rola [00:02:55] Merci, merci Emmanuelle. Donc oui, d'origine d'ailleurs, moi je suis originaire du Liban et puis mon mari et mes deux filles sont d'origine palestinienne en fait. Donc on vient pas du même pays, mais vous pouvez donc imaginer cette histoire de migration continue et parfois comment la réalité d'avoir un pays occupé et colonisé aussi marque profondément notre parcours dans la vie. Donc le fait de venir de la Palestine, c'est une situation qui a effectivement façonné notre identité et influencé nos expériences personnelles et aussi professionnelles. Bon, il y avait toujours des défis d'instabilité et d'insécurité, mais en même temps beaucoup de résilience et de détermination. Donc moi, j'ai complété mes études scolaires universitaires au Liban jusqu'au master, c'est-à-dire à l'université libanaise, à Beyrouth. J'ai un master en didactique des sciences puis mon doc ici à l'Université de Montréal. Donc, j'ai débuté ma carrière aussi au Liban comme enseignante avant de me déplacer au Qatar avec mon mari. Et puis au Qatar, j'ai travaillé plusieurs années comme enseignante, puis directrice adjointe et responsable du développement professionnel des enseignants, avant de prendre la décision encore une fois d'émigrer au Canada. Et puis ça s'est fait en 2009, notre émigration avec mes deux filles âgées de cinq et trois ans. Donc elles étaient très petites, puis le détachement familial a été très difficile pour elles et c'est toujours comme ça le détachement familial. Puis, c'était la question de l'adaptation à un nouveau pays, à un nouveau système éducatif. Puis il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs qui restent encore présents. Au Canada, j'ai entamé mes études doctorales en psychopédagogie à l'Université de Montréal, c'était fin 2009, 2009-2010. Puis juste après avoir terminé mon doctorat en 2015, je suis retournée au Qatar. J'ai accepté un contrat comme directrice d'école primaire internationale, système IB, International Bac. Puis ce contrat a durée trois ans et m'a permis vraiment d'acquérir une expérience très précieuse en gestion d'établissement, puis aussi en accompagnement des enseignants et soutien à l'apprentissage puis à l'enseignement. Et je suis revenue au Canada après trois ans, mais cette fois-ci en Ontario pour un an, avant de m'installer au Québec en 2018. Donc beaucoup d'allers-retours. Mon parcours, vraiment, a été marqué par de nombreux allers-retours entre différents pays. Mais ça, c'est tellement riche parce que ça enrichit vraiment mon expérience et mes compétences aussi en éducation. J'ai vraiment accumulé une vaste expérience à l'international en tant qu'enseignante, directrice adjointe et directrice d'école aussi au Liban, au Qatar. J'ai oublié de citer Jordanie aussi parce que j'ai vécu aussi un an en Jordanie. Donc des contextes vraiment différents de celui du Québec. Ça, c'est tellement riche, mais c'est en même temps un petit peu fatiguant parfois lorsqu'on change beaucoup de pays, surtout pour les filles, parce qu'elles doivent chaque fois s'adapter à des systèmes éducatifs qui sont différents, qui sont pas les mêmes. Et aussi je dis que c'est exigeant parce que quand par exemple, après avoir développé des stratégies pour intégrer le système au Québec la première fois, je devais repartir pour le Qatar, puis à mon retour, c'était comme si je devais vivre une nouvelle intégration en Ontario, puis au Québec. Donc ça demande beaucoup d'efforts pour trouver toujours ta place. Et c'est la même chose pour les autres membres de la famille. Donc, comment ce parcours a influencé mon choix? En fait, je crois que mes expériences de vie m'ont sensibilisée aux enjeux de l'inclusion et surtout de la diversité parce qu'on a changé beaucoup de contextes, beaucoup de pays, beaucoup d'expériences, beaucoup de systèmes éducatifs et je me suis intéressée dès le début aux pratiques enseignantes et à l'apprentissage, surtout que j'étais moi-même enseignante, puis directrice adjointe, responsable de développement professionnel. Donc j'étais proche des besoins, en fait, des enseignants. Mais c'est surtout en arrivant au Québec que la question de la diversité a pris une place plus importante dans mon parcours. C'est comme si ce concept, je l'ai perçu différemment un petit peu au Québec. Ça évolue un petit peu ce concept et c'est une autre perception vraiment de la diversité. Donc, étant moi-même issue de l'immigration, mère de deux filles qui ont dû s'adapter à un nouveau pays, à un nouveau système éducatif dès leur jeune âge, donc j'ai développé une sensibilité particulière à ces enjeux. Et par la suite, c'est lorsqu'on approfondit notre compréhension de la diversité et les enjeux de la diversité que la question de l'inclusion est devenue plus... c'est devenu comme une préoccupation majeure pour moi, surtout au cours des dernières années. Et puis, je voyais l'importance croissante de ce sujet dans le contexte éducatif international, pas seulement au Québec. Pour moi, c'est comme un concept qui s'inscrit dans une perspective d'équité, de démocratie et de justice sociale. Mais aussi moi, je le situe dans un cadre vraiment large, qui va au-delà d'une classe inclusive au Québec ou bien en Ontario, un cadre vraiment mondial avec le droit des enfants partout dans le monde, leur droit à une éducation de qualité, peu importe le contexte géographique. Donc c'est ça, je crois que c'est ce parcours, mes différentes expériences qui ont enrichi ma perspective en tant que chercheuse, me poussant peut-être à m'engager pour une éducation plus équitable, plus inclusive. Je ne prétends pas qu'on est dans une éducation inclusive, mais on a toujours cette volonté de travailler pour y arriver. Puis aussi ma compréhension des difficultés liées à l'émigration, les défis, les obstacles, les richesses aussi. Tout ça m'a incitée à m'intéresser à l'inclusion des élèves issus des milieux similaires, tout en valorisant leur parcours, leurs histoires, leurs récits, mais aussi comment donner des voix à leurs histoires, comment dévoiler vraiment les histoires d'une manière très équitable aussi, sans catégoriser.
Emmanuelle [00:08:58] C'est passionnant, c'est passionnant et j'aime t'entendre parler de tout ça. Tes expériences sont extrêmement variées, riches aussi. Tu as parlé de nouveaux pays, de nouveaux systèmes, mais tu n'as pas parlé de nouvelle langue. Est-ce que tes filles ont toujours été scolarisées dans un système francophone?
Rola [00:09:16] Non, en fait non. C'était pas le cas au Qatar, comme elles avaient le français comme langue seconde. Mais finalement parce qu'elles sont arrivées ici à trois ans, puis à cinq ans, au début, surtout, la petite, elle a vraiment résisté. Elle voulait pas apprendre une nouvelle langue, elle veut tout le temps parler en arabe, mais parce que peut-être, parce que lorsqu'on est jeune, l'intégration parfois est plus simple, plus rapide, ça fonctionne bien par la suite. Mais moi aussi j'étais comme... j'ai préféré qu'elles maîtrisent plusieurs langues en même temps l'arabe, le français, l'espagnol et l'anglais. Mais on a pas le droit ici, parce qu'il faut passer vraiment par le système francophone et je comprends cet enjeu, que je voulais qu'elles apprennent plusieurs langues en même temps français, anglais, espagnol. Puis à la maison on parle l'arabe, on lit en arabe aussi. On regarde la télévision en arabe, en français, en anglais. Donc je suis contente qu'elles soient multilingues maintenant. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile.
Emmanuelle [00:10:20] C'est un défi, mais un défi dans le bon sens du terme. C'est un défi intellectuel, un défi émotionnel. Est-ce qu'il y a une langue que tu considères plus comme ta langue maternelle que l'autre?
Rola [00:10:32] Oui, c'est l'arabe. L'arabe, c'est ma langue maternelle, oui. Pour les filles je sais pas vraiment. Peut-être c'est différent, je sais pas elles sont à l'aise plus avec quelle langue. Mais pour moi c'est l'arabe.
Emmanuelle [00:10:46] Alors on comprend bien comment tes expériences ont contribué à ta compréhension des défis. Mais maintenant, la majorité de ton travail se situe dans un cadre éducatif, le cadre de l'école et tu t'es intéressée à la question des enseignants. Alors tu as été enseignante toi-même, directrice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça, de comment est-ce que tu as pu te déplacer dans ce que pouvaient vivre les enseignants et la manière dont ils comprennent ces défis ou non d'ailleurs?
Rola [00:11:19] Mais c'est comme si j'ai une double posture ici, chercheuse mais aussi praticienne. Donc deux postures qui se complètent parce que c'est ça qui m'a permis aussi de mieux comprendre les défis vécus par les enseignants. Parce que moi j'ai été enseignante, puis j'ai travaillé aussi avec les enseignants. Donc premièrement, c'est bien de dire que mes perceptions de la diversité puis de l'inclusion ont vraiment évolué dépendamment du contexte géographique où j'ai travaillé.
Emmanuelle [00:11:49] Moi aussi.
Rola [00:11:51] Parce que c'est vraiment, c'est pas la même chose avec tous les défis, puis les obstacles, puis la manière dont on perçoit aussi ces concepts. Donc, en termes de défis, parce que j'étais enseignante au Liban puis au Qatar, j'ai moi-même fait face aussi à des défis concernant l'inclusion des élèves. Peut-être avant 20 ans, on utilisait pas le terme inclusion, mais c'est vraiment le même sens, l'apprentissage, la réussite scolaire et éducative des élèves. Donc c'est ça, parce qu'au Liban, j'étais enseignante dans des écoles publiques, mais c'était un système éducatif relativement fragile, disons, malheureusement. Donc les défis étaient vraiment nombreux. Et au Qatar, j'ai accompagné des enseignantes dans leur développement professionnel continu. Mais c'était toujours des questions comme comment mettre en place des pratiques qui favorisent l'apprentissage de tous les élèves? Comment soutenir tous les élèves, comment différencier leur pédagogie, comment développer un climat de classe propice pour l'apprentissage de tous les élèves? Comment évaluer les élèves en les soutenant, pas nécessairement mesurés, ou bien dans le sens de l'évaluation vraiment formative. Donc c'était des questions que je travaillais avec les enseignantes, mais l'avantage était parce que j'étais avec elles dans l'école, parce que c'était une école publique aussi. Donc j'ai pu suivre le développement des enseignantes. Donc il s'agissait pas seulement de leur donner une formation théorique, puis de les laisser se débrouiller seules, mais de trouver des solutions ensemble. Donc c'est ça qui a été aussi très avantageux au Qatar, soutenir les enseignants dans la mise en place des pratiques. Je fais des observations de classe pour voir comment ça se fait, la mise en pratique. Puis à ce niveau, je crois qu'on commence à réaliser que les défis sont aussi systémiques et structurels, qu'ils s'enracinent parfois dans une culture éducative particulière. Peut-être il y a certains enseignants qui résistent au changement ou bien qui ont peur du changement, mais d'autres ont la volonté de changer. Mais le système parfois les ralentit ou bien les freinent. Et surtout, lorsque le système éducatif ne s'arrime pas avec le besoin de la société, parce que ça, c'est un point très important à partir d'observations puis de lectures. Les systèmes éducatifs dans certains pays qui ont été colonisés ou bien occupés, ou bien je sais pas, soumis à des agendas politiques, leurs systèmes éducatifs ne s'alignent pas nécessairement avec les besoins réels. La société, c'est comme si on a un système importé qui est soumis à une hégémonie culturelle coloniale parfois. Donc à ce niveau, on commence vraiment à prendre conscience que c'est une question de système, une question de structure, pas seulement des enseignants, que les défis sont parfois dus à un système très rigide et ça nous permet aussi de sortir d'un discours lacunaire en ce qui concerne les enseignants, puis percevoir les défis selon un autre angle. Puis au Québec, c'était dans le même sens, mais plus à titre de chercheuse ici au Québec. Ma compréhension des concepts de diversité et d'inclusion, comme je dis, avant c'était différent, ça a vraiment évolué. Mais mon séjour dans les classes, par exemple, pour préparer ma thèse, des discussions informelles avec les enseignants, participants, les projets de recherche récents que je mène dans divers milieux ont aidé à mieux comprendre aussi les défis rencontrés par les enseignants. Mais certains de ces défis sont aussi dus au système et à une absence de volonté politique, parfois de promouvoir l'éducation équitable. Donc c'est pour dire que cela nous permet de ne pas attribuer les défis uniquement aux caractéristiques intrinsèques des enseignants ou bien caractéristiques intrinsèques des élèves ou bien des parents, mais de regarder plus dans une perspective très large. Ça met en lumière la complexité des défis de l'inclusion, puis de la diversité. Elle montre l'importance d'un soutien continu, d'une adaptation des politiques aussi éducatives pour répondre aux besoins réels des élèves et des enseignants. Quand je reviens au Qatar ici, l'accompagnement personnalisé des enseignants a démontré qu'on peut trouver des solutions contextuelles qui peuvent faire une différence dans la mise en place des pratiques. Mais toujours, le rôle du système des politiques reste important. Et puis ça me permet de comprendre que les obstacles, comme j'ai dit avant, ne sont pas dus à des résistances individuelles. Non, les enseignants ont la volonté, ils veulent vraiment faire des changements, ils veulent promouvoir l'apprentissage et favoriser la réussite de tous les élèves. Mais on parle de structures, de systèmes rigides. Donc, c'est comment changer notre manière d'aborder les défis de l'inclusion, de la diversité. Il faut développer une prise de conscience des enjeux structurels qui entravent les changements nécessaires pour une éducation inclusive sinon on ne peut pas mettre toute la pression sur les personnes enseignantes.
Emmanuelle [00:16:45] Absolument passionnant et j'aime beaucoup ce que tu dis sur la sortie d'un discours lacunaire en ce qui concerne les enseignants. Et puis tu as ajouté un petit peu plus loin et les parents. Parce que fut un temps où quand l'enfant ne réussissait pas, c'était, pour les parents, la faute des enseignants, pour les enseignants, la faute des parents et/ou bien la faute des élèves, il fallait les réparer. Et maintenant on est entré dans une approche beaucoup plus, beaucoup plus globale du système qui pose des questions aussi. Alors pour revenir quand même au centre, si on travaille avec les enseignants, c'est, tu le dis très bien, pour la réussite des élèves. Donc je voulais te demander si tu pouvais partager avec nous, avec les auditeurs, une expérience personnelle, un moment où tu as été touchée par la voix, par un témoignage d'élèves. Et comment ça a pu orienter ta recherche sur la construction de leur expérience socio-scolaire?
Rola [00:17:51] Oui, intéressant. C'est pour cette raison que je t'ai dit, au début, que j'aime ça le regard croisé élève-enseignant, parce que peut-être c'est en lien avec quelque chose que j'ai vécu. Bon, il y en a plusieurs mais il y avait cette élève, c'était lors de ma thèse. Puis lors de ma thèse, j'ai fait des observations de classe, puis des entrevues avec des enseignants, puis avec des élèves aussi issus de l'immigration, de l'immigration récente, mais qui ne maîtrisent pas encore le français comme langue d'enseignement. Donc, c'était pas facile en fait de faire parler les élèves, pas seulement qui ne maîtrisent pas la langue, mais qui sont en processus d'intégration, qui sont peut-être encore dans le choc, dans la discontinuité culturelle. Puis, c'est pas facile pour ces élèves qu'ils parlent de leur vécu parce que peut-être ils sont pas conscients c'est quoi le vécu, ça signifie quoi. Donc c'était le cas avec oui, une élève en particulier, toujours je pense à cette élève. C'était pas facile de faire l'entrevue avec elle. Mais c'est pas ça l'idée. C'est pas qu'elle n'a pas parlé ou bien qu'elle n'a pas agi, mais c'est qu'elle est encore vraiment en processus d'adaptation, je sais pas d'intégration, peut-être un petit peu choquée. Et ça nous apprend beaucoup de choses en tant que chercheuse, mais aussi en tant que personne qui observe ces élèves qui ne se sentent pas nécessairement à l'aise, pas nécessairement en sécurité, surtout au début de leur arrivée dans la société d'accueil, et puis on peut l'observer facilement pour certains élèves. Et ils nous le disent parfois lors des entrevues, ils n'arrivent pas à se faire des amis, à s'intégrer. Ils parlent beaucoup de leur réussite dans les pays d'origine, ils étaient très bons à l'école, tout va bien à l'école. Donc c'est aussi le sentiment de compétence ici, comment ils se sentent en arrivant ici. Puis on le sait, ils ont besoin d'un temps pour s'adapter. Mais en attendant ce temps, leur adaptation, il ne faut pas aussi ignorer leur voix et ignorer ce sentiment de compétence. C'est leur droit de développer aussi le sentiment de compétence. Pour cette raison, je dis que je vais toujours travailler sur ce regard croisé élèves-enseignants pour mieux comprendre le vécu scolaire des élèves parce que je crois qu'il est important de faire comprendre aussi leur vécu socio-scolaire aux enseignants et aux autres acteurs et actrices scolaires, puis de donner une voix aussi à ces élèves. Puis en même temps ces observations, puis ce contact avec les élèves ont enrichi mes approches méthodologiques, parce que toujours je me pose la question mais comment travailler davantage oui, sur un regard croisé, mais comment développer des outils pour permettre vraiment à ces élèves de s'exprimer. Parce que faire des entrevues, c'est ce que je fais maintenant. Des entrevues avec des élèves, je trouve que c'est pas suffisant. J'ai pas vraiment accès à leur vécu socio-scolaire, donc c'est toujours en réflexion cette question comment faire avec ces élèves pour ne pas les instrumentaliser finalement? Parce qu'ils sont pas des objets de recherche ces élèves. Puis comment puis-je dévoiler toujours leur résilience, leur capacité à s'adapter? Peut-être aussi dans mon stage, des témoignages dans mon stage post-doctoral, lorsque j'ai interviewé des enseignants, c'était un projet sur des récits de pratiques des enseignants, puis c'était dirigé par Geneviève Audet. Donc les enseignants, ils ont parlé des situations en lien avec des élèves réfugiés. Et ça, c'était vraiment, vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Comment le comportement puis les attitudes parfois de ces élèves est mal perçu, mal interprété par le personnel scolaire, on trouve que ça, c'est vraiment triste et c'est injuste, comme s'il y avait des comportements qui sont pas conformes aux normes scolaires. Puis on donne pas le temps aux élèves de s'adapter, puis on est en train de juger, puis d'interpréter leurs perceptions. Et puis, même sur le plan personnel, je peux dire que j'étais toujours touchée par le vécu scolaire de mes deux filles parce que ce que j'ai noté que même après treize, quatorze ans de leur scolarité ici au Québec, elles parlent jusqu'à maintenant des situations de malaise qu'elles ont vécues à cause de la différence culturelle ou bien comment on a ignoré, comment la diversité et les différences ont été comme inaperçues dans leur vécu scolaire. Donc, ce sont des souvenirs toujours qui laissent des traces. Mais c'est ça qui nous sensibilise sur le plan personnel et professionnel aussi.
Emmanuelle [00:22:23] Oui Rola, moi aussi j'ai quatre enfants que j'ai emmenés d'un pays à un autre et j'ai aussi, comme je les ai toujours scolarisés dans des systèmes publics, j'ai aussi vécu ces expériences de décalage dont ils parlent encore, alors souvent avec humour maintenant, parce que finalement ça les forme aussi. Ça les forme à l'interculturel, à condition qu'ils soient soutenus et valorisés par ailleurs, ce qui est super compliqué dans une situation où la migration n'est pas choisie et où les parents sont souvent eux-mêmes complètement débordés par les situations, les défis auxquels ils ont à faire face. Est-ce que, je pense avec tout ce que tu racontais, c'est amusant parce que tu parlais des élèves qui parlent de leur réussite. J'ai entendu ça tellement souvent, des élèves qui disaient mais j'étais la meilleure dans ma classe, dans tel... etc. en Turquie. Et figure-toi que j'ai même rencontré des adultes. Je me souviens d'une directrice d'école aux Pays-Bas qui me disait qu'elle avait été traumatisée à l'âge de sept ans parce qu'en Turquie, elle était la meilleure dans sa classe et ils lui avaient fait redoubler sa classe en arrivant aux Pays-Bas. Et ça la traumatisait encore aujourd'hui. C'est fou! Alors qu'elle avait réussi, elle était directrice d'école, etc. Donc je pense que ma question suivante, c'est vraiment... Ok, c'est intéressant, tu nous as montré comment est-ce que, quelque part, ces expériences représentaient pour toi des points d'ancrage pour développer de nouveaux outils ou bien plutôt des solutions innovantes, mais est-ce que tu peux nous parler de l'une ou de l'autre? Parce que maintenant, moi je suis curieuse. Qu'est-ce que tu proposes?
Rola [00:24:14] En ce qui concerne les élèves, comme je te l'ai dit donc, c'est comment faire parler les élèves, comment leur permettre de s'exprimer sur leur vécu, leurs besoins, mais aussi comment susciter leur intérêt pour participer à un projet de recherche. Parce que c'est pas la même chose que les personnes enseignantes et c'est vraiment un défi pour certains élèves. Je suis en collecte de données actuellement, mais c'est une question en réflexion. Quand, par exemple maintenant on a décidé d'utiliser une autre langue que le français pour les élèves qui ne maîtrisent pas le français, mais c'est pas vraiment la seule solution. Donc c'est toujours une question en réflexion. Mais par contre, en ce qui concerne les enseignants, parce qu'aussi c'est une question comment analyser les pratiques rapportées par les personnes enseignantes tout en respectant leur discours puis leur voix, comment ne pas responsabiliser les enseignantes, quelles pratiques sélectionner, quelles pratiques dévoiler, quelles pratiques documenter. Et puis, à partir de la recherche, comment contribuer à la formation des personnes enseignantes. Parce que la question qu'on se pose toujours est pourquoi la personne enseignante accepte t-elle de participer à un projet de recherche? C'est pour l'avancement de connaissances? Bon c'est correct, quelles connaissances? Les connaissances théoriques? Mais leurs connaissances à elles parce que leur pratique, donc comment faire pour soutenir les enseignants lors de ce processus de collecte de données dans le développement de leurs pratiques enseignantes. Donc, c'est ça. Alors j'ai trouvé, j'ai développé, je suis en train de tester maintenant un dispositif, je fais des entrevues de type compréhensif avec les élèves, mais qui est suivi par ce que j'ai appelé des groupes de discussion entre plusieurs enseignants qui viennent de contextes différents, d'écoles différentes pour parler, pour partager leurs pratiques qu'ils considèrent et qu'elles considèrent inclusives. Puis vraiment faire ce type de discussion entre les enseignants et donc comment ça permet vraiment de prendre conscience, premièrement, de ce qu'on est en train de faire dans nos classes, de nos pratiques efficaces ou pas efficaces. Mais comment, lorsqu'on partage ces pratiques, on peut améliorer, on peut faire cette réflexion sur nos propres pratiques pour... pas transformer, pour développer, disons, pour ajuster, pour adapter davantage ces pratiques. Donc les groupes de discussion comme espace de partage, de réflexion, mais par la suite de développement, d'adaptation et de transformation. Donc j'ai utilisé ce dispositif dans deux projets de recherche en cours. Puis ça, j'ai trouvé que j'aime beaucoup tester ce dispositif pour voir à quel point c'était efficace pour les enseignants, puis comment faire autrement pour le développer davantage. Est-ce que ça doit être suivi, par exemple, par d'autres entrevues individuelles? Il faut faire plusieurs groupes de discussion pour pemettre à ces enseignants vraiment de développer leurs pratiques. Donc ça, c'était plus en termes de pratiques enseignantes et comment je peux contribuer à la formation à travers les projets de recherche.
Emmanuelle [00:27:22] C'est passionnant et beaucoup de liens avec ce que moi je fais ou j'essaye de faire avec l'École amie des langues à ce propos, où les enseignants en fait, le but c'est d'avoir effectivement ce partage. Moi, dans mon parcours professionnel, j'ai découvert qu'en fait les enseignants, c'étaient souvent des personnes très humbles, qui ne partageaient pas facilement, qui fermaient la porte de leur classe parce qu'ils avaient peur de faire mal. Et que... juste quand ils sont soutenus... j'ai bien aimé parce que tu as dit aussi « pour parler de leurs pratiques qu'ils considèrent inclusives ». J'ai trouvé ça amusant parce que c'est vrai, parce que parfois on pense qu'on est inclusif. Et puis en fait, il y a encore des choses qu'on peut améliorer pour y arriver.
Rola [00:28:11] Oui, exact. Puis parfois on prend pas conscience qu'on est en train de mettre en place des pratiques inclusives, donc aussi dans les deux sens.
Emmanuelle [00:28:17] Oui, je me souviens de moi-même, dans les années... au début des années 2000, j'enseignais beaucoup le français et j'étais vraiment dans l'approche communicative de l'enseignement. Et quand je demandais à mes étudiants de se lever pour parler en français, j'étais convaincue que c'était très inclusif. Et puis maintenant, je me rends compte que ça a pu être finalement perçu par certains comme très agressif.
Rola [00:28:42] Intéressant.
Emmanuelle [00:28:44] Et envahissant. Donc j'ai eu besoin de quelques années pour découvrir ça, mais aussi de la rétroaction de certains étudiants. Certains adoraient, il y en avait qui adorait cette manière de faire, mais d'autres qui ont été peut-être très blessés aussi par ce type d'approche. Donc c'est comme ça qu'on apprend et je trouve ça très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des moments où toi aussi tu as pu être surprise par les réactions des enseignants? Alors là on sait, tu as parlé de groupes de discussion avec les enseignants, peut-être avec les élèves aussi dans ce cadre?
Rola [00:29:19] Dans ce cadre peut-être, oui. Parfois, lorsque des personnes enseignantes décrivent leurs pratiques en classe, puis comme je t'ai dit avant, elles ne prennent pas conscience à quel point ça peut être vraiment inclusif, ou bien comment ça favorise la réussite des élèves. Parfois, vraiment, elles parlent d'un climat inclusif, pas seulement d'une pratique singulière ou bien accidentelle. Moi je dis non, si c'est vraiment un climat de classe très inclusif, parfois on est vraiment impressionné par le discours aussi inclusif des enseignants, pas leurs pratiques. Un discours inclusif qui met pas la responsabilité sur les parents, sur les élèves. Donc c'est vraiment... ils parlent d'une responsabilité collective aussi, comment ils travaillent pour engager les parents. Donc ce sont des moments qui nous impressionnent, mais aussi peut-être dans d'autres contextes. Si je vais t'amener ailleurs au Liban, dans un projet de recherche qui a été fait au Liban auprès des personnes enseignantes qui enseignent à des élèves réfugiés syriens, parce que les outils méthodologiques, ça a un petit peu différent, disons, le contexte est radicalement différent. Donc moi, j'étais par exemple impressionnée, pas seulement par les pratiques décrites par les enseignants, mais à quel point les enseignants, malgré les problèmes de connexion d'Internet, les problèmes d'électricité, c'était très difficile pour les enseignants d'utiliser Zoom, par exemple, parfois on fait les entrevues par WhatsApp. Donc, mais à quel point ils étaient vraiment résilients pour compléter, pour participer à ce projet de recherche et pour dévoiler, pour parler de leurs récits. Donc ça, c'était aussi impressionnant. Puis la question qui m'habitait mais pourquoi ces personnes enseignantes sont en train de faire ça? Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire à partir de ça? Donc, malgré tous les obstacles, malgré tous les défis, malgré la crise économique au Liban, la crise sociale, la crise politique, ces enseignants qui sont pour la plupart des réfugiés, des enseignants réfugiés qui vivent dans des camps de réfugiés et toutes les difficultés. Mais malgré ça, ils ont accepté de participer. Ils ont fait la rencontre, ils ont répété la rencontre une, deux, trois fois pour compléter vraiment, comme on dit, leur participation au projet de recherche. Donc ça, c'était aussi impressionnant et ça nous responsabilise, ça nous donne aussi un sentiment de responsabilité envers ces enseignants. Donc comment vraiment faire pour diffuser leurs voix, pour dévoiler leurs récits et pour parler de leurs pratiques. Et c'est ce qu'on a fait. On a développé comme un recueil de leurs récits de pratiques, puis on l'utilise ici au Québec pour sensibiliser les personnes enseignantes aussi aux questions en lien avec l'apprentissage des élèves réfugiés. Donc oui, c'est ça. Parfois, comme chercheuse, parfois on a des attentes, mais les réactions des personnes enseignantes vont au-delà de nos attentes. Mais ça crée toujours un sentiment de responsabilité. Comment rester fidèle à leur discours, à leur attitude? Puis ça façonne aussi notre manière de mener des recherches. Oui c'est ça, parce que lorsqu'on est sur le terrain, notre interaction avec les participantes, ça doit avoir des influences sur nos outils méthodologiques, sur notre posture aussi comme chercheuse. Donc on ne peut pas être neutre.
Emmanuelle [00:32:43] Je trouve ça absolument passionnant parce que d'abord tu construis des ponts et là tu dis que tu as fait cette recherche au Liban. Mais plus que ça, tu as ramené l'expérience du Liban pour enrichir la perception et les pratiques des élèves au Québec. Ce que je trouve magnifique et je dis toujours on a tellement à apprendre de ces enseignants, de ces écoles qui vivent dans cette situation finalement beaucoup plus extrême que les nôtres, même s'il faut reconnaître que moi, j'ai visité deux écoles la semaine dernière ici en Ontario, et j'ai senti exactement ce dont tu parlais, ce climat d'inclusivité, cette responsabilité collective dont tu parles, alors qu'ils sont dans des situations très difficiles. Ils ont énormément d'élèves nouveaux arrivants, alors qu'en fait on enlève les capacités du personnel en retirant des enseignants, ce qui est une situation absolument absurde. On a de plus en plus d'élèves, avec plus en plus de besoins diversifiés et puis finalement, on retire des enseignants. Mais malgré tout ça, ce climat d'inclusivité, de responsabilité collective qui nous responsabilise, nous enseignants aussi. Et cette question mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils veuillent participer à nos projets? C'est très très beau et je me reconnais tout à fait dans ton témoignage. Peut-être est-ce que tu as envie de partager quelques histoires ou des expériences que des enseignants ou des élèves t'ont partagées sur ta compréhension de l'inclusion et de la diversité en éducation?
Rola [00:34:41] Oui, bien sûr, mais aussi ce que j'ai appris moi-même, comment aussi ma perception de l'inclusion, puis des pratiques inclusives à changer. Ça évolue parce que maintenant je considère les pratiques inclusives comme des pratiques singulières, contextualisées dans un contexte précis, dans une classe précise aussi. Donc c'est comme s'il n'y a pas de recette, il n'y a pas des pratiques qu'on considère efficaces, universelles, que nous pourrions recommander, par exemple, aux personnes enseignantes. C'est quelque chose qu'on apprend aussi à travers la recherche. Oui, il existe peut-être de grands principes comme collaborer avec les parents, collaborer en équipe, valoriser la langue d'origine, la culture d'origine. Donc ce sont vraiment des grands titres qui sont en lien avec ce concept d'inclusion mais à l'intérieur de chaque grand titre, il y a comme des petites actions. C'est comme... c'est-à-dire que chaque pratique est unique, adaptée à chaque enseignant. C'est ce que cherche à dire. Une pratique prise pour des raisons spécifiques avec un objectif spécifique, une visée particulière peut-être. Donc, il y a cet agir, je vais le dire comme ça, cet agir singulier et particulier à chaque enseignant. C'est ça qui fait la différence. C'est pour dire qu'une pratique inclusive dans une classe A n'est pas vraiment nécessairement inclusive dans une classe B. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris des enseignants. Donc bon, ils ont partagé avec moi plusieurs pratiques. Je peux nommer par exemple, surtout lorsque je travaille regards croisés par exemple, une pratique comment donner une place à un élève récemment arrivé, par exemple, de parler de sa culture d'origine en classe, puis l'élève en entrevue qui a beaucoup parlé de ce point-là, à quel point elles se sont satisfaites, puis comment ça permet à l'élève de développer son sentiment d'appartenance à la classe. Donc c'est un petit détail. Parfois, l'enseignante ne fait pas attention à quel point c'est important, mais c'était tellement important pour l'élève comme pratique qui a favorisé son inclusion. Pour une autre élève par exemple, comment le fait de travailler toujours en équipe de deux ou bien de trois, mais c'est à elle de choisir ses coéquipiers. Comment vraiment ça développe son sentiment aussi de sécurité en classe. Donc elle peut travailler en sécurité avec ses amis en classe. Et je répète des petits détails mais qui font une grande différence. Une enseignante par exemple, je sais pas elle, à quel point elle prend conscience de l'importance de ça, mais elle parle comment elle apprend. C'était en classe d'accueil secondaire, comment elle apprend l'histoire à ses élèves. Elle insiste beaucoup sur l'apprentissage de l'histoire, puis l'histoire de la colonisation aussi, pour ne pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Donc, c'est ce qu'elle dit. Mais pour elle, ça développe la conscience critique puis la conscience citoyenne chez les élèves. Donc aussi, on peut voir ça comme une pratique inclusive, mais c'est la manière d'approcher le sujet. Donc ce n'est pas seulement l'enseignement de l'histoire qui est une pratique inclusive non, c'est la manière dont cette enseignante vraiment utilise le matériel pour mener des questions, des questionnements aussi auprès des élèves. Par exemple, un enseignant qui trouve de la difficulté à nommer une pratique inclusive parce que pour lui tout ce qu'il fait en classe, c'est de l'inclusion. Et il a tellement raison. Le climat de la classe, la routine, le respect des différences, l'ouverture d'esprit, l'adaptation continue, c'est de l'inclusion aussi. Mais c'est ça, pour une autre enseignante, c'est comment développer des projets éducatifs avec les parents pour les engager. Mais c'est vraiment... c'est le respect du capital social, du capital culturel des parents. Pas seulement respecter et valoriser le vécu des parents, non, c'est pas la même chose. C'est respecter leur capital social. Parce que les parents qui viennent ici, ils viennent pas n'importe où, ils ont leur capital aussi. Ils ont ce qu'on appelle le Funds of Knowledge. Donc comment respecter ce capital, c'est ça? Bon, si je parle... au Liban, c'est un autre niveau là-bas. Là-bas, c'est vraiment comment convaincre les parents. Je parle des élèves réfugiés, le projet auprès des élèves réfugiés. Comment convaincre les parents d'inscrire les élèves dans les écoles, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau du système, au niveau des documents et tout ça. Donc c'est un autre niveau d'inclusion. Mais quand même, les enseignants qui travaillent fort aussi pour favoriser la réussite de leurs élèves. Donc comme une autre panoplie de pratiques, dépendamment du contexte.
Emmanuelle [00:39:37] Oui, tout à fait. Chaque contrainte sociétale amène à repenser ces pratiques inclusives, ces pratiques pédagogiques, inclusives ou non d'ailleurs. Alors, on arrive vers la fin. Donc question un peu provocatrice : si demain, tu étais convoquée par le ministère de l'Éducation, quelles sont les recommandations que tu leur ferais? Peut-être que tu as été convoquée d'ailleurs par le ministère de l'Éducation!
Rola [00:40:12] Non. Plusieurs en fait. Plusieurs recommandation, malheureusement. Mais je crois que ça commence... il faut être à l'écoute des besoins des personnes enseignantes, soutenir, accompagner ces personnes enseignantes, reconnaître aussi les conditions de leur travail mais aussi améliorer les conditions de travail en réduisant par exemple les classes surchargées. Donc... parce qu'il y a plusieurs défis, on parle du manque de services, manque de ressources, système d'évaluation très traditionnel, pénurie de personnel, il n'y a pas de soutien, il y a pas d'accompagnement. Donc il y a vraiment plusieurs défis. Mais en même temps, être à l'écoute des élèves aussi et de leurs parents pour mieux comprendre les besoins des élèves. Parce que si on va parler d'un système juste, inclusif, équitable, je sais pas, dans une école démocratique, c'est ça ce qu'il faut faire. Être à l'écoute des acteurs scolaires et actrices scolaires. Mais aussi au Québec plus particulièrement, s'il faut déconstruire le système qu'on appelle le système scolaire à trois vitesses au Québec, c'est un système qui contribue à accroître les inégalités entre les élèves des écoles publiques d'une part, puis les élèves ayant accès aux programmes sélectifs des écoles publiques et aux écoles privées, parce que finalement, tous les élèves doivent avoir accès à une éducation de qualité, peu importe leurs caractéristiques, leur statut, où ils vivent au Québec. Et c'est ça, c'est en lien avec... Il faut assurer une répartition équitable des ressources, des services entre toutes les écoles, parce qu'on parle jusqu'à maintenant des écoles défavorisées puis des écoles favorisées, mais on n'a pas les mêmes ressources, les mêmes services. Et peut-être un dernier mot, c'est comment il faut utiliser un discours politique inclusif pour éviter d'influencer négativement les perceptions des personnes enseignantes, puis des acteurs et actrices scolaires. Parce que parfois, on n'est pas inclusif dans notre discours et on catégorise et on pointe par le doigt une catégorie des élèves, soit les élèves issus de l'immigration, soit les élèves récemment arrivés, soit les réfugiés, soit les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Mais c'est ça, parce que les perceptions des enseignants, parfois, elles sont construites socialement et c'est le discours politique, puis le discours public qui fait en sorte qu'on a des perceptions d'ouverture ou bien des perceptions parfois qui catégorisent ou bien qui sont négatives à l'égard de la diversité, ou bien de l'inclusion. Et c'est la responsabilité du gouvernement, du ministère de l'Éducation.
Emmanuelle [00:42:57] J'aime beaucoup ça. En t'écoutant, on a envie vraiment d'approfondir la connaissance de ton travail. Donc s'il y avait un ou deux articles que tu nous recommanderais pour mieux lire ton travail ou même un livre, lesquels est-ce que tu nous recommanderais.
Rola [00:43:15] En fait, mon livre sur l'enseignement en milieu multiethnique, ça s'est inspiré de ma thèse doctorale. Ça c'est intéressant à lire parce que aussi ça inclut plusieurs situations d'interaction entre élèves issus de l'immigration récente et enseignants. Puis aussi, j'aime beaucoup un article que j'avais publié avec des collègues dans la revue Prospects de l'UNESCO. C'est en lien avec le projet de recherche que nous avons mené au Liban. Ça s'appelle “Making a Difference” with Syrian Refugee Students in Lebanon.Donc, ça parle un petit peu... On a donné la voix à quatre enseignants et enseignantes au Liban pour parler de leur situation, des situations vécues avec des élèves réfugiés syriens au Liban. Ils ont dévoilé des récits, des histoires. Ils ont parlé de leurs pratiques. Mais ça montre aussi à quel point ils étaient résilients puis comment ils travaillent fort pour favoriser la réussite de ces élèves. Donc j'aime beaucoup cet article. Puis un article, ça date de 2016, mais je l'apprécie beaucoup parce que ça montre comment je fais des micro-analyses pour analyser des situations d'interaction élèves récemment arrivés qui ne maîtrisent pas la langue et l'enseignant. Ça s'appelle Les pratiques enseignantes de soutien. Un travail de négociation du sens entre l'élève et l'enseignant, dans la revue Innover dans la tradition de Vygotski, ça porte sur l'approche vygotskienne, puis sur l'interaction élève-enseignant.
Emmanuelle [00:44:43] Passionnant. Passionnant. Alors tu as beaucoup d'autres cordes à ton arc. Par exemple, tu, je crois, codiriges une revue en ligne pour les enseignants qui est en arabe, c'est ça?
Rola [00:44:57] En fait, je suis co-fondatrice, je co-dirige pas, je suis co-fondatrice de cette revue. C'était en 2020, puis c'est toujours en cours. C'est une revue très intéressante parce qu'il y a un manque dans le monde arabe de revues professionnelles et ça porte sur des articles professionnels en arabe, en éducation bien sûr, parce que aussi ça valorise la production du savoir en arabe. Donc, c'est comme j'ai parlé avant, on n'est pas dans une posture de consommer seulement le savoir importé, mais c'est vraiment produire un savoir qui dépend du contexte arabe aussi. Donc oui, c'est une revue qui apparaît quatre fois par année, avec toujours des dossiers thématiques, puis des articles qui portent sur plusieurs sujets, avec des entrevues, avec un pédagogue, une pédagogue du monde arabe. Oui, c'est ça.
Emmanuelle [00:45:51] Merci Rola. J'aimerais bien travailler avec toi. J'aime beaucoup t'entendre parler. C'est absolument passionnant ton expérience. Alors aujourd'hui, tu nous as parlé de valorisation, d'amélioration des conditions, de soutien, d'accompagnement, d'être à l'écoute. C'est quelque chose que tu as utilisé beaucoup, se mettre à l'écoute à la fois des enseignants et des élèves. Tu nous as parlé aussi de discours politique inclusif. J'aime beaucoup ça, parfois de convaincre, d'entreprise où il s'agit de convaincre aussi bien les parents que les enseignants, mais aussi de sensibilisation. Donc on sent cette différence entre convaincre et puis sensibiliser ou bien simplement prendre conscience. On voit différents stades dans tes processus de recherche. Tu nous as parlé aussi des sentiments et du droit que l'élève avait de se sentir compétent même quand il arrive dans un système dans lequel il est complètement déstabilisé. Bref, on a brossé beaucoup de choses ensemble, on a traversé même plusieurs paysages. Allez, si tu pouvais nous dire en une phrase ton rêve ou ton plus grand rêve, ou ta vision pour l'éducation.
Rola [00:47:08] En une phrase, c'est très difficile de dire une phrase. Mais c'est sûr, c'est l'inclusion, c'est l'éducation de qualité, mais pas l'éducation de qualité comme c'est défini selon les besoins du marché ou bien selon le système néolibéral. Éducation de qualité qui dépend vraiment du contexte, qui permet de développer la conscience critique de nos élèves, leur pensée critique pour comprendre le monde, pour comprendre le système d'oppression, pour comprendre ce système néolibéral qui manipule, les rapports de pouvoir aussi, les forces et tout ça. Donc c'est ça qui permet à ces élèves d'agir, de dire non et de ne pas rester conforme au système. Et c'est ce qu'on voit actuellement à Gaza. Donc comment oser parler de l'inclusion puis de l'éducation de qualité avec des élèves, avec toute cette destruction systémique des institutions scolaires, avec l'éducide, l'épistémicide. Donc c'est ça, on rêve d'une éducation de qualité, mais qui est définie selon le contexte géographique, pas seulement selon un contexte néolibéral qui vraiment manipule le monde entier. C'est ça.
Emmanuelle [00:48:27] Merci. Permettre aux élèves d'agir. Je crois qu'on va terminer là-dessus et puis continuer d'oser parler d'inclusion malgré toutes les injustices du monde et les injustices en cours. Merci Rola.
Rola [00:48:40] Oui, c'est notre responsabilité. Merci, merci beaucoup.
Emmanuelle [00:48:43] Merci Rola.
Rola [00:48:43] Merci Emmanuelle.
Joey [00:48:45] Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo.oise@utoronto.ca