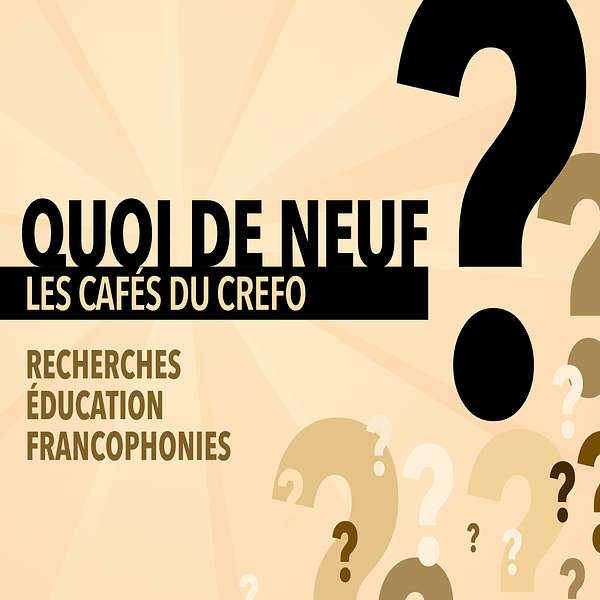
Quoi de neuf ?
Quoi de neuf ?
La recherche comme voyage : De nouveaux questionnements à chaque étape, de nouveaux horizons à chaque rencontre : Entretien avec Emmanuelle Le Pichon
Dans cet épisode, Marie-Paule Lory, directrice par intérim du CREFO, rencontre Emmanuelle Le Pichon, professeure agrégée à l'Université de Toronto.
Emmanuelle Le Pichon est professeure agrégée au département de Curriculum, Teaching and Learning à l'Université de Toronto. Auparavant, elle a travaillé à l'Institut de linguistique de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Ses recherches portent sur le plurilinguisme en éducation. Depuis 2009, elle a dirigé plusieurs projets nationaux et internationaux sur l'inclusion des élèves issus des minorités dans l'éducation. Elle travaille en tant que consultante, chercheuse, évaluatrice et examinatrice pour plusieurs organisations et revues internationales. Elle a participé à des analyses de politiques, notamment pour la Commission Européenne (NESET II, Sirius, Erasmus +) et le Migration Policy Institute (Washington DC, mai 2015). Son vif intérêt pour les politiques migratoires l'a amenée à diriger des recherches sur des questions liées à l'éducation plurilingue, en particulier sur l’éducation des élèves migrants nouvellement arrivés en Europe et au Canada et des élèves autochtones au Suriname (en collaboration avec la Rutu Foundation). En 2015, son rapport de recherche a été au centre d'un débat sur les questions liées aux migrants et à l'éducation au parlement néerlandais qui a finalement abouti à l'obtention d'une subvention de 15 millions d'euros pour soutenir les écoles primaires destinées aux élèves réfugiés en 2016.
Ces dernières années, elle a siégé, entre autres, aux conseils d'administration de l'Association néerlandaise de linguistique appliquée (2012-2017), du Comité d'éthique de l'Institut de linguistique d'Utrecht (2016-2017) et de la Commission d'éducation pour les étudiants de premier cycle (2015-2016) et de deuxième cycle (2016-2017) du Département de Languages, Literature and Communication à l'Université d'Utrecht, ainsi que du Comité d'équité et du Comité d'appel académique du Graduate Department de l'Université de Toronto, OISE (2018-présent).
Emmanuelle a pris la direction du Centre de recherches en éducation franco-ontarienne en 2018. Elle est actuellement en congé sabbatique jusqu’à juillet 2025.
Recherche :
Pédagogies plurilingues et technologies numérique pour soutenir l’apprentissage des STEM, chercheuse principale (CRSH)
Cette étude vise à mettre en œuvre et à évaluer l'impact d'un programme en ligne axé sur les STEM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques) qui combine une interface hautement engageante avec le choix de plusieurs langues dans les régions où il y a un nombre supérieur à la moyenne d'apprenants de langues dans les écoles. Le partenariat comprend 4 universités et 3 grands partenaires communautaires. Ce partenariat cherche à élucider 1) le niveau d'engagement des étudiants dans l'apprentissage des contenus STEM, 2) la mesure dans laquelle les fonctionnalités multilingues favorisent le progrès académique, 3) la propension des étudiants à accéder aux contenus académiques en français, et 4) les expériences des enseignants quant à l'utilisation de cette technologie. Nous explorons également diverses stratégies pour soutenir les enseignants dans l'apprentissage de l'intégration des outils numériques multilingues dans le curriculum STEM, y compris le développement collaboratif de ressources. Nos résultats contribueront au développement de pratiques pédagogiques innovantes et de nouvelles politiques éducatives pour soutenir les élèves linguistiquement diversifiés au Canada et en France.
Présentation des résultats : https://www.youtube.com/@TeachingSTEMtoMultilingualSs_
Les Écoles amies des langues : des pratiques pédagogiques équitable
Joey [00:00:00] Dans cet épisode, Marie-Paule Lory, directrice par intérim du CREFO, rencontre Emmanuelle Le Pichon, professeure agrégée à l'Université de Toronto.
Emmanuelle [00:00:07] Il a dit que c'est exactement le contraire de ce que l'école devrait faire. L'école devrait ajouter pas retirer. Et c'est exactement ça. Alors toute la question est de savoir comment ajouter tout en tenant compte des limites des enseignants.
Joey [00:00:23] Bienvenue à Quoi de neuf?
Marie-Paule [00:00:39] Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Paule Loy et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui pour ce balado du CREFO Quoi de neuf? une de vos animatrices habituelles Emmanuelle Le Pichon. Alors Emmanuelle, bonjour et merci d'accepter de changer de rôle et de te laisser questionner durant ce balado. Comment tu te sens à l'idée de vivre cette expérience de ce côté du micro?
Emmanuelle [00:01:02] Bonjour Marie-Paule et merci de m'avoir invitée. Écoute, heureuse de pouvoir un peu partager mais je voudrais d'abord dire que de mener ces séries de podcast, ça m'a amenée à apprendre tellement de choses de tous mes interlocuteurs, que très souvent, en les écoutant, je me sens très très humble. Et voilà. Alors être mise dans ce siège tout d'un coup de celle qui doit partager et parler. C'est vrai que c'est un peu oui, impressionnant peut-être.
Marie-Paule [00:01:34] Merci. Aujourd'hui, ce que j'aimerais c'est que l'on parle ensemble notamment de parcours linguistique, d'identité et d'éducation. Alors j'ai pu voir en consultant ta biographie que ce sont des thèmes qui te tiennent très à cœur et autour desquels tu as développé un nombre de projets impressionnant. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ton parcours, notamment linguistique, et de l'impact de ces trajectoires sur ton ou plutôt tes identités?
Emmanuelle [00:02:01] Oui, alors je vais essayer d'être brève. C'est quelque chose que j'ai raconté un peu dans une de mes publications dont je crois, on va parler tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai été très très marquée par mes propres expériences d'apprentissage ou d'enseignement de la langue, et puis aussi par le fait de devenir un jour maman de quatre enfants que j'ai trimballés à travers les langues et les cultures. Donc oui, il y a un parcours riche en apprentissage, en passages de frontières, en passages de langues. Je ne commencerai pas à l'école parce que c'est vrai que j'ai appris des tonnes de langues à l'école, mais sans beaucoup de succès. Donc pour moi, c'est la première leçon, c'est que la manière dont j'ai été enseignée et ma disposition à l'époque par rapport à cet enseignement des langues n'étaient pas adaptées à mes besoins, à qui j'étais, à mes désirs, à mes... Voilà, donc ça, c'est ma première leçon. Après ça, j'ai toujours eu envie d'ailleurs. Donc, au milieu de mes études, j'étudiais la littérature à Paris, à la Sorbonne, je suis partie faire un an de volontariat en Italie et là j'ai appris l'italien sur le tas. J'ai pris aucun cours, j'ai appris en parlant en fait, et très vite je crois, au bout de trois mois, je parlais couramment l'italien. Je le parlais et je le comprenais très bien. Et puis j'avais une relation très très forte avec ce peuple que je m'étais mise à aimer au point où je me voyais faire ma vie en Italie. Donc voilà, ça c'était la première expérience. Personne ne m'a jamais enseigné quoi que ce soit en italien et pourtant je l'ai parlé très vite, très couramment et on me disait à l'époque que j'avais un accent romain. Ensuite, je suis tombée amoureuse d'un Hollandais donc je suis partie en Hollande. Et là j'avais très envie de faire une thèse. Donc il a fallu, pour entrer à l'université, que j'apprenne le néerlandais de manière beaucoup plus académique. Et donc là, j'ai pris des cours de langue néerlandaise à l'université pendant un an avec un groupe d'étudiants du monde entier pour qui l'enjeu était le même, pouvoir faire des études secondaires aux Pays-Bas. Alors, une toute nouvelle exposition à la langue, une langue qui ne m'était pas familière du tout, ce n'était pas une langue latine et un dépaysement total du point de vue de la culture. Je me sentais beaucoup moins liée à ces personnes même si mon amoureux était Hollandais. J'ai eu beaucoup plus de mal à les comprendre. Je pense que ça m'a pris au moins deux ou trois ans. Voilà. Et puis ensuite, il a fallu que je gagne un peu ma vie. Donc j'ai commencé à enseigner et là je suis passée de l'autre côté. Alors c'était la grande époque de l'enseignement des langues communicatif et avec des documents dits authentiques. En fait, quand on regarde maintenant en arrière, les documents étaient pas du tout authentiques, c'était vraiment des coupures de journaux qui étaient simplifiées, etc. Alors, on essayait de le faire le mieux possible. Moi, je me souviens, je me servais beaucoup de RFI et Radio France Internationale où ils font vraiment un effort, les journalistes font vraiment un effort de parler distinctement, lentement, etc. Mais bon l'authenticité en fait, on savait qu'il fallait l'introduire, mais on n'était pas très certain de la manière dont il fallait le faire. Donc c'est très intéressant de repenser à tout ça parce que Dieu sait que j'ai dû faire un nombre important d'erreurs. Alors, j'avais des étudiants qui m'aimaient énormément, et puis j'en avais d'autres qui avaient plus de mal. Et je me rends compte aujourd'hui que c'était lié à cet enseignement dit communicatif, authentique, dans lequel on forçait un peu les gens à parler la langue à apprendre. On leur disait « Allez, lève-toi, vas-y, c'est ton tour, parle ». Et on pensait vraiment qu'ils apprendraient comme ça. Et on ne tenait aucun compte de l'insécurité ou plutôt on en tenait compte de cette insécurité linguistique mais on essayait de la forcer. En fait, on forçait les gens à parler, à s'exprimer. Et chez certaines personnes, ça créait des dommages. Voilà. Et puis, à la même époque, j'ai commencé à avoir des enfants qui ont été élevés dans cette culture franco-néerlandaise, on va dire. Et moi je me suis découvert un attachement à la langue française comme je n'aurais jamais pu imaginer. Pour moi, c'était très important que mes enfants puissent être considérés comme des Français en allant en France. Et aujourd'hui, je me dis, avec le recul, que peut-être que je me projetais un peu. Je voulais aussi qu'ils puissent communiquer avec leurs grands-parents, avec leurs cousins. Voilà, qu'ils entrent dans cette communauté familiale et puis plus large que ça. Donc, je me suis beaucoup battue. Alors là, un autre type d'apprentissage, on dit acquisition pour les langues chez les petits, mais en fait ce n'est pas tout à fait juste parce qu'on dit que les enfants apprennent tout seuls, mais ce n'est pas juste non plus. Les parents mettent un effort phénoménal à transmettre une langue qui n'est pas la langue de l'environnement à leurs enfants. Alors ça peut prendre toutes sortes de formes. Et dans mon cas, on a redoublé d'imagination pour renforcer cette langue qu'on aimait tant. Alors les livres, les histoires, les poèmes, les jeux de langues, on cherchait des mots qui étaient les mêmes dans toutes ces langues, mais dans ces deux et puis après l'anglais, parce qu'on est partis aux États-Unis, donc voilà. On a vraiment énormément travaillé là-dessus et chacune des réactions de mes enfants était pour moi un apprentissage et une sorte de tilt d'ouverture à Wow, ok ça se passe. Donc, je me souviendrai toujours par exemple, quand on est arrivés aux Etats-Unis, ma fille Isaure avait cinq ans et une des voisines vient nous voir et lui dit quelque chose de très gentil « Ah bonjour, ma petite. Comment vas-tu? » en anglais. Et là, ma fille la regarde et fond en larmes, mais fond en larmes. Alors, c'était gênant parce que la dame vraiment, il n'y avait pas plus gentil. Elle lui demandait quelque chose de vraiment gentil. Et en fait, c'était cette anxiété, cette panique de ne rien comprendre à ce qui lui était dit et puis de ne pas être capable de répondre, de ne pas maîtriser. À cinq ans! Et là, moi je voulais naïvement la mettre à l'école publique. Et puis c'est mon mari qui « Ah regarde, l'école française internationale ! » en plus l'État français à l'époque nous sponsorisait à fond, donc on pouvait y aller. Ah c'est chouette parce qu'elle aura le français et elle aura l'anglais. Et alors là, du coup j'ai accepté. On a fait rentrer nos enfants dans cette école et là ça a été merveilleux parce qu’en français. Et voilà, je me souviens, elle avait fait le test de français avec les enseignantes et enseignants, ressort en me disant votre fille parle au passé simple et c'était parce que je lui avais tellement lu d'histoires, je lui avais lu toutes les histoires etc. que finalement moi j'étais sa source d'exposition à la langue française et elle avait adopté ces manières de parler, ces manières de... voilà ! Et puis elle est rentrée tout doucement dans l'anglais avec des enseignants qui redoublaient d'intelligence et de gentillesse pour aider les enfants à entrer dans cette langue. Donc voilà, pour faire court, voilà beaucoup de passages de frontières puis après un retour aux Pays-Bas qui a été wow, vraiment brutal et ensuite un redépart au Canada. Là, j'ai vu des adolescents qui devaient de se réadapter à encore une nouvelle ancre, encore une nouvelle culture, encore une nouvelle manière de faire, aussi une nouvelle manière de pressentir, non seulement l'enseignement des langues, mais l'enseignement en général. Et là, mon arrivée au Canada a vraiment été un tremblement de terre dans ma manière de penser et de voir. Parce que là, je me suis aperçue oh là là, mais ça va bien au-delà de la langue. La langue est le vecteur principal, tout passe par la langue, mais en fait ça va bien au-delà de ça. Il y a toute une complexité autour de ça qui fait de la langue le point essentiel de l'enseignement apprentissage, mais auquel on ne pense pas forcément. Par exemple, on en parlera tout à l'heure j'imagine, mais lorsqu'on est un enseignant de maths, de sciences, mes enfants arrivant ici étant testés en mathématiques, on leur a refilé un test comme ça, sans leur demander ce qu'ils avaient appris avant, sans se soucier du tout de leur niveau d'anglais. Et on leur a dit vas-y, remplis. Et en fonction de ça, ils ont été placés dans une classe qu'on pensait correspondante à leur niveau. Donc voilà un tas d'expériences, aujourd'hui on dirait traumatisantes, moi je ne dirais pas traumatisantes, je dirais oui, bien sûr, chacune implique un changement de perspective, un changement de... mais qui ont profondément marqué à la fois ma vie personnelle, ma vie familiale, mais aussi ma vie professionnelle et en particulier ma recherche.
Marie-Paule [00:11:21] Merci beaucoup Emmanuelle. Dans ce que tu viens de nous parler, on voit à la fois les éléments forts de l'apprentissage d'une langue avec une imagination débordante pour véhiculer une langue. Également, tu parles de la gentillesse nécessaire dans le développement langagier et tu fais aussi référence à l'anxiété, à la panique, au fait de ne pas maîtriser et aussi surtout à l'insécurité qui est un sujet fort quand on parle de la francophonie en Ontario. Est-ce que depuis ton arrivée en Ontario, ce concept d'insécurité a changé ta manière de voir le développement langagier? Comment tu te positionnes par rapport à ça aujourd'hui?
Emmanuelle [00:11:59] Oui et non. Alors oui, évidemment et non, parce que l'insécurité, c'était un grand sujet dans ma recherche déjà, puisque j'ai fait ma thèse sur la compétence communicative chez les petits enfants et en particulier je me suis intéressée aux enfants justement plurilingues et à l'impact de l'apprentissage d'une langue par rapport au plurilinguisme qui leur était donné à la base, c'est-à-dire des enfants qui avaient grandi dans ces langues sans justement avoir un apprentissage concret, c'est-à-dire à l'école, d'une langue supplémentaire. Donc voilà, ça c'était ma thèse et il y avait toute cette notion d'insécurité qui était très, très forte. Je vous ai parlé de ma fille qui s'était mise à pleurer, mais il y avait, je me souviens j'avais demandé aux enfants de faire des dessins et il y avait une petite fille qui m'avait dessiné un élève qui arrivait en Chine et qui parlait à une maîtresse qui avait un grand sourire, qui avait l'air très gentille et de la bulle qui partait de la bouche de la maîtresse, il y avait des signes, une calligraphie qui ressemblait à une calligraphie qu'on dirait chinoise. Voilà. Et puis la petite fille dans sa bulle à elle, il y avait plein de points d'interrogation et une bouche ouverte comme ça : What, what, what! Donc c'est vraiment un sujet qui m'a toujours fascinée au point où, quand j'étais aux Pays-Bas, j'ai fait un certain nombre d'études sur le silence, ces enfants silencieux, et j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup marquée. En fait, j'avais rencontré, à l'époque, une psychologue qui était venue me voir et qui m'avait dit « Emmanuelle, est-ce que tu pourrais m'expliquer, il se trouve que dans mon cabinet, j'ai beaucoup d'enfants plurilingues qui sont mutiques, qui ne disent... ». Voilà mutiques, ça s'appelle le mutisme sélectif. Et donc qui ne parlent pas du tout, du tout du tout. Et est-ce qu'il y a des études là-dessus? Et donc nous, on connaît la période silencieuse qui a été établie il y a plus de 30 ans maintenant par certains de nos éminents collègues. Mais en fait donc, j'ai comparé les critères de cette période silencieuse à ceux du mutisme sélectif dans ce domaine. Et en fait, je me suis aperçue que, en allant dans les classes, en interrogeant les enseignants, le silence des enfants pouvait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long que les trois mois dont on parlait dans la période silencieuse, trois à six mois. Moi, j'ai rencontré des enfants qui avaient été silencieux deux ans, trois ans, quatre ans silencieux complètement à l'école. Donc c'est très très impressionnant. Et en fait, la raison pour laquelle c'était mal connu, c'est que les enseignants sont très désarçonnés par ce type de réaction. Ils se sentent très culpabilisés, tristes même. Ils savent comment faire avec un enfant qui montrerait une hyperactivité, mais ils savent pas comment faire avec un enfant qui est hyper silencieux et puis qui montre une certaine tristesse aussi. Et donc très souvent, ça passe sous le silence. Donc voilà quelque chose finalement d'assez... donc voilà, je me suis beaucoup intéressée à ça. Alors maintenant, pour en revenir au français, c'est très intéressant. Donc j'arrivais de France, le français, voilà, c'était majoritaire, évident. Les Français c'était, on disait, c'est des gens qui parlent pas bien les langues étrangères. J'arrive aux Pays-Bas et là il y avait un amour assez fort du français, pays presque frontalier, allez on va dire avec voilà les Néerlandais qui passent beaucoup de leurs vacances en France, qui aiment les coins de camping, etc. Donc un statut social certain, mais une langue en perte de vitesse, donc une langue minoritaire et qui commençait à être minorisée pour des raisons économiques. En fait, à l'époque où j'enseignais aux Pays-Bas, l'Allemagne prenait son envol au niveau économique et la France commençait à ramer. Et donc l'allemand devenait de plus en plus populaire à l'école et le français était de plus en plus délaissé, d'autant plus que l'allemand est beaucoup plus facile pour les Néerlandais que le français. Donc voilà, j'arrivais de là, je me dis j'arrive au Canada, deux langues officielles, français, anglais. Et là j'ai découvert les francophonies canadiennes. Est-ce qu'il faut rentrer dans cette polémique? J'ai surtout découvert le CREFO. Le CREFO, c'est le Centre de recherches en éducation franco-ontarienne qui m'a accueillie à bras ouverts, à bras ouverts. Ça a été un accueil incroyable par des collègues comme bien sûr toi, mais Diane Gérin-Lajoie, Diane Farmer, Monica Heller, Norman Labrie, enfin, voilà. Des gens absolument formidables qui m'ont fait comprendre que j'étais la bienvenue, mais qui m'ont aussi fait comprendre que la situation était drôlement complexe. Et je pense que l'une des personnes qui m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est Joey, c'est Joey qui est le pilier du CREFO parce qu'il en fait une grande partie de l'administration, les finances, etc. et qui ensemble, on avait démarré ce podcast, j'avais dit Joey, est-ce que tu veux bien faire la phrase introductrice du podcast? Parce que je dois l'avouer, il a une très, très belle voix, grave, une voix qui porte. Et il me dit Ah mais il n'en est pas question! Ah bon? Mais pourquoi pas? Il me dit parce que mon accent, ça va pas. J'ai dit comment ça, mon accent ça va pas? Il me dit non, non. Et là, il a commencé à m'expliquer, il m'a dit que quand il était arrivé à l'université, on s'était fichu de lui, les professeurs lui disaient qu'il parlait pas bien le français. C'est un francophone qui a appris le français à la maison, de base, qui a toujours été à l'école en français. Et là, je suis tombée de ma chaise. Mais enfin! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il m'a dit non, je n'avais pas le bon accent. Au point où ça l'a poussé à abandonner le français et à faire sa thèse en anglais à l'époque. C'est quand même quelque chose. Et ça m'a beaucoup choquée et je lui ai dit écoute, qu'à cela ne tienne. Moi je trouve que tu as une très belle voix. Et puis peut-être que tu peux être le porte-parole de tous ceux ou celles qui ont pu vivre cette expérience douloureuse, qui ont été déstabilisés par cette expérience et puis d'une certaine manière, relégitimiser ce bel accent, cette belle histoire que tu portes dans ta manière de parler. Et donc il l'a fait très étonnamment, il s'est laissé convaincre. Et voilà, ce sont les secrets de la petite introduction. Donc oui, je préfère en parler par des petites expériences plutôt que dans les grandes lignes, parce que j'aurais peur de marcher sur un terrain qui n'est le mien que par adoption.
Marie-Paule [00:19:13] Quand tu parles de l'expérience de Joey, des expériences auxquelles tu es à l'écoute, tu as pu finalement en publier de ces expériences dans un des ouvrages qui s'appelle Voix et visage du français en Ontario. Perspectives de pédagogues en formation, et c'est aux éditions Prise de parole. Et dans cet ouvrage, tu écoutes des étudiants, tu donnes la parole à des étudiants en formation et des étudiants qui vont parler de leurs identités francophones au pluriel, mais aussi de leur trajectoire. Qu'est-ce qui t'a poussée finalement à faire un tel ouvrage et qu'est-ce que tu retires de cette expérience?
Emmanuelle [00:19:50] Alors, c'est important pour les auditeurs de savoir que, au CREFO, on fait non seulement de la recherche, mais aussi de l'enseignement. Dans le centre, chacun d'entre nous enseigne un certain nombre de cours et ce sont des cours que nous enseignons en français, au cœur du CREFO, et dont les problématiques touchent, vont aussi au-delà, mais touchent à ces questions de francophonie, d'identité. Et donc, dans ce cadre, j'ai donné, j'ai repris d'ailleurs, un cours qui avait été créé par notre chère collègue Diane Farmer et sur lequel nous nous penchions explicitement sur ces questions. Et aussi par les podcasts d'ailleurs, j'ai été amenée à poser la question à ces étudiants, mais de savoir comment ils se situaient par rapport à cette francophonie. C'est important de comprendre que, en France, si vous demandez la définition de la francophonie, c'est soit je parle français, donc je suis francophone, soit les gens vont penser aux territoires d'outre-mer. Vous savez, ces territoires avec un mandat avec la France, donc en fonction du territoire en question et où les peuples parlent français et souvent d'autres langues. Donc quand on parle de francophonie, c'est de ça qu'on parle. Au Canada, quand on parle de francophonie, on parle de tout autre chose, on parle de l'histoire du Canada, on parle de l'histoire de la colonisation, on parle de voilà, de peuples. Et donc ce qui me frappait, c'était que nos étudiants, qui sont pour la plupart des étudiants qui se destinent à l'enseignement en français ou du français en Ontario, je dis pour la plupart parce que c'est pas tous absolument mais beaucoup, avaient des origines d'abord très très diverses, et puis des expériences aussi très très diverses par rapport à ces langues, en fonction des personnes qu'ils avaient rencontrées dans leur vie, de leur parcours, de leurs histoires un peu dans le sens de la question que tu m'as posée au début. Alors je pense à Jasmine qui elle, avait des racines québécoises, pareil pour Annie, mais en ce qui concerne par exemple Doug, lui, il arrivait du Brésil. Doug, c'était un vrai polyglotte qui avait parcouru le monde et qui parle, je crois, une dizaine de langues. Il y avait Divij, qui lui était mauricien et Divij posait des questions assez provocatrices parce qu'il disait comment ça se fait que l'enseignement du français, ça marche à l'île Maurice mais ça ne marche ici? Vous voyez, donc c'était vraiment... ils étaient très... ils voulaient comprendre ensemble, on voulait comprendre et moi, je voulais comprendre leur rapport à la francophonie et surtout ce qui les avait amenés à choisir le français au point de vouloir l'enseigner ou enseigner dans cette langue. D'où venait cet amour profond de cette langue? Mais malgré les expériences douloureuses qu'ils avaient pu vivre les uns et les autres au travers de la Francophonie, c'est vraiment ça qui m'a... Et puis il y avait une deuxième raison pour laquelle je voulais faire ce livre, c'était que je pense qu'on a une image de l'enseignant francophone en Ontario très stéréotypée. On pense... enfin, chacun peut réfléchir en lui-même, là fermer les yeux et se dire mais pour moi, quel est l'enseignant francophone type en Ontario? Et en fait, mes classes ne correspondaient pas du tout à ce stéréotype. Donc je voulais quelque part rétablir une certaine vérité sur les identités de ces enseignants amoureux du français. Alors, si on a des images stéréotypées, c'est probablement parce que le paysage de la francophonie a énormément changé ces quinze dernières années, avec énormément d'arrivage, dont je fais partie d'ailleurs, dans les quinze dernières années qui ont profondément chamboulé le paysage francophone de l'Ontario ces quinze dernières années. Et à mon avis, pour le meilleur.
Marie-Paule [00:24:41] Et en fait, c'est une action majeure grâce à ce livre que tu as pu mener pour soutenir la francophonie en Ontario. Quelles sont ces actions qui te semblent aujourd'hui importantes à mener pour continuer à promouvoir, à soutenir cette francophonie plurielle en Ontario?
Emmanuelle [00:25:00] Tu me poses des questions difficiles. Je pense que c'est très, très important de réaliser que chacun d'entre nous... il ne faut pas toujours déléguer la tâche à son voisin. Chacun d'entre nous peut avoir un rôle majeur dans le maintien de ces droits qui ont été obtenus par des gens qui se sont battus pour avoir la reconnaissance de leurs droits et qui continuent à se battre. On l'a vu, moi ça m'a beaucoup impressionnée quelques années après, je crois que c'était en 2019-2020 où il y a eu des attaques très fortes du gouvernement par rapport à la francophonie en Ontario. Et on a vu tous ces francophones, par des températures glaciales, se retrouver dans la rue, affrontant le froid dans une bonhomie, avec à la fois une détermination, mais en même temps une bonne humeur, un enthousiasme et surtout la conviction de la légitimité de leur requête. Donc ça, ça m'a énormément frappée. Donc je pense que c'est très important que chacun d'entre nous réalise que les droits ne sont jamais acquis. Donc il faut se battre jour après jour, minute après minute, pour ces droits, pour le maintien de ces droits. Et ça, je pense que les francophones de l'Ontario et du Canada en général le savent très, très bien et c'est clair, par la manière dont ils sont capables de se mettre ensemble pour défendre une cause qui leur tient à cœur et qui les réunit tous. Ça, c'est la première chose. Je dis que chacun a son rôle à jouer parce que moi je suis très très impressionnée par.... On pense souvent aux politiciens, mais en fait, je suis très impressionnée par nos étudiants et les enseignants, évidemment, qui jouent un rôle majeur dans l'éducation à la francophonie. Qu'est-ce que c'est, comment on fait? La vraie question, c'est comment faire aimer cette langue et tout ce à quoi elle se rapporte pour que l'individu souhaite s'identifier à cette langue le moment venu. Et ça, c'est un défi. Ça, c'est la question à 1 million de dollars qui nous occupe, toi et moi, chaque jour. Mais quelque part, là encore, j'ai été nourrie par la manière dont j'ai élevé mes enfants. Avec mon mari, c'était très clair que si on voulait que la langue se maintienne, il fallait qu'on la fasse aimer. La langue ne doit pas être le but en soi. Elle doit être le moyen qui permet d'arriver quelque part. Ça, c'est très important. Donc il faut trouver cet objectif et puis ensuite mettre les éléments en place pour pouvoir y arriver. Donc chacun a son rôle à jouer et c'est une mission importante. Voilà, on avance avec des échecs. Moi je suis sûre que j'ai fait beaucoup de bourdes et d'erreurs. Eh bien l'important c'est de les reconnaître et de se relever et de recommencer et de réessayer. Est-ce que j'ai répondu à ta question, peut-être de manière un peu détournée?
Marie-Paule [00:28:40] Mais tout à fait. Merci Emmanuelle. Et tu parles beaucoup de l'émotion, de l'affect dans ce développement langagier. Et c'est quelque chose, je pense, que l'on retrouve dans un des projets que tu as faits, un projet d'envergure qui est l'École amie des langues, pour soutenir le droit à l'éducation des minorités linguistiques. C'est un projet également d'envergure internationale impressionnant. Et peux-tu nous en parler?
Emmanuelle [00:29:09] Oui, alors ça c'est vraiment mon cinquième bébé, je dirais, le projet qui me tient le plus à cœur parce que je l'ai mûri pendant de nombreuses années avec ma collègue et amie Ellen-Rose Kambel, qui est, elle, juriste et moi à la base linguiste. Donc elle, elle venait d'une perspective de la langue en tant que droit, droit universel. Chaque enfant a le droit d'être enseigné dans une langue qu'il comprend. Et ça, c'est quelque chose que tous les pays du monde ont signé, ça s'appelle la Convention des droits de l'enfant, et ça fait partie de la Convention des droits de l'enfant. Chaque enfant a le droit d'être éduqué dans une langue qu'il comprend. C'est très important de le savoir. Donc ce n'est pas une option. C'est un devoir qui a été signé par chacun des pays dans lesquels j'ai pu évoluer. Et puis moi, j'arrivais de la perspective de la langue en tant que ressource, c'est-à-dire comment mettre à profit toutes ces langues pour pouvoir arriver à un épanouissement maximal. C'est bien de parler d'épanouissement parce que finalement, en éducation, ce qu'on veut pour les élèves, c'est qu'ils s'épanouissent. Ils s'épanouissent dans le cognitif, l'émotionnel, l'affectif, le social, etc. Qu'ils trouvent leur place dans la société, ça c'est très important. Donc depuis quinze ans, je me pose la question de savoir quelle place doivent avoir toutes ces langues dans cet apprentissage, enseignement pour permettre un épanouissement optimal. Et je me suis très très vite aperçue que finalement le problème n'était pas l'élève. Le problème n'a jamais été l'élève. Tu sais on a passé des années à vouloir changer les élèves. Alors, non mais c'est parce que... s'il y arrive pas, c'est parce qu'il ne se donne pas assez de mal ou parce que... Alors après ça a été ah non, c'est ses parents, s'il n'y arrive pas, c'est à cause de ses parents, c'est parce qu'il parle pas la bonne langue. Alors on a voulu changer l'élève, on a voulu changer les parents et finalement, on se pose peu la question de savoir mais est-ce que c'est pas l'enseignement qui n'est pas adapté à l'élève plutôt? Les ressources, elles sont là, mais en fait on s'en sert pas. C'est comme si en fait, on vous offrait une boîte à outils à Noël et que vous ne vous serviez que d'un marteau alors que la boîte à outils a plein plein d'outils différents. Donc le marteau, il va marcher pour enfoncer les clous, mais il ne va pas marcher pour scier une planche. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était comme des outils qui étaient inutilisés et puis finalement qui finissaient par disparaître. Un des directeurs d'une école ici en Ontario, qui est école amie des langues, quand on lui a demandé pourquoi il voulait que son école devienne amie des langues, c'est Roberto di Prospero, il faut que je le dise, puisque c'est un homme remarquable. Il nous a dit parce que moi je suis entré à l'école avec deux langues et je suis sorti avec une. Et il a dit, c'est exactement le contraire de ce que l'école devrait faire. L'École devrait ajouter et pas retirer. C'est exactement ça. Alors toute la question est de savoir comment ajouter tout en tenant compte des limites des enseignants. Et des limites des ressources, des limites des programmes scolaires. C'est la grande question que nous nous posons. Alors, l'École amie des langues, elle a aussi été nourrie par la littérature. J'ai énormément lu, énormément enseigné et de toutes ces lectures, on a un peu, avec ma collègue, rassemblé les bonnes pratiques et on en a fait quelque chose de très simple pour les écoles, c'est-à-dire les écoles quand elles entrent dans le réseau, elles s'engagent à ne pas punir, ni blâmer un élève pour la langue qu'il parle. Au contraire, elle s'engage à mettre en valeur ses langues et elle s'engage à veiller à ce que l'élève ne soit jamais mis en situation ou le moins possible mis en situation d'insécurité par rapport à ses langues. C'est un engagement qui est global, qui est un engagement de toute l'école. Donc il peut y avoir des enseignants qui adhèrent moins à ce genre de pratiques. Mais en fait, le directeur signe ou la directrice signe un contrat et s'engage à ce que ce ceci soit respecté. Donc c'est comme une charte en fait, une charte. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est de voir que, eh bien, de faire cela, ça donne des ailes, des ailes aux enseignants. Des ailes qui peuvent se réaliser dans toute leur créativité, inventivité et il suffit de leur donner ça aux enseignants pour qu’eux-mêmes, il n'y a pas besoin de leur dire quoi faire, ils sont extraordinaires. Et donc nous, on ne leur impose rien parce qu'on part du principe que chaque communauté scolaire est différente de la suivante, parce que c'est dans un quartier différent, avec des populations différentes, des familles différentes, des enseignants différents, etc. des staffs différents. Mais chacune a la possibilité de s'épanouir. La grande spécificité des Écoles amies des langues, c'est qu'on en a en camps de réfugiés, on a des écoles autochtones, une en Amérique du Sud, on a des écoles internationales, on a des écoles publiques, on a des écoles privées. Je n'ai jamais vu un réseau qui rassemblait des écoles aussi différentes les unes des autres et qui apprenaient autant les unes des autres. Et je peux vous dire que, que ce soit une école avec beaucoup de moyens ou une école avec moins de moyens, les injustices sont les mêmes. Il y a autant de discriminations et d'injustices qui sont menées simplement, l'argent souvent masque beaucoup de ces discriminations et de ces injustices. Elles sont beaucoup plus visibles souvent dans les écoles où il y a moins de moyens. Voilà. Donc on dit toujours c'est vers celles-là qu'il faut agir, mais en fait non. Il y a autant d'injustices dans des écoles internationales et il y a vraiment un très très gros travail de fond à faire dans ces écoles. Donc voilà, ce sont des écoles qui ont pour premier objectif de célébrer chacun ou chacune de leurs élèves, de leurs enseignants, de leur staff dans ce qu'elles ont de plus précieux, c'est-à-dire leurs langues. Et alors, ça a des effets incroyables, incroyables. Alors c'est vrai, tu disais d'ampleur, ça me fait rire quand on dit ça, parce qu'en fait, on a commencé en 2019 avec deux écoles. Et puis là aujourd'hui, on est en train de revoir le mode de gouvernance parce qu'on a du mal à suivre. On n'en a plus de 52 dans le monde entier, y compris la Chine, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les Caraïbes et on a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre parce que on n'a pas les moyens physiques et financiers de soutenir concrètement ces écoles. Donc voilà, il y a un grand, grand, grand besoin et on a besoin de soutien aussi bien pratique que financier, que politique. Voilà, donc on accueille tout le monde.
Marie-Paule [00:37:00] Un projet formidable. Deux questions me viennent en tête quand tu présentes ce projet. La première est et le mandat de l'école dans tout ça? Comment l'École amie des langues s'inscrit dans le ou les mandats de l'école d'aujourd'hui? Et ma deuxième question, c'est que ce projet traverse tellement de frontières, à tous les niveaux, premier ou deuxième degré, quel est ton secret pour mobiliser autant d'acteurs et d'actrices en éducation à participer à ce projet École amie des langues?
Emmanuelle [00:37:32] Alors le mandat, c'est une très bonne question parce qu'en fait, une des premières choses qu'on demande aux écoles de faire quand elles entrent dans le réseau, c'est... Oui, c'est assez spécifique de nos écoles, c'est-à-dire que chez nous, vous faites la demande pour devenir école amie des langues. On a un entretien avec vous, vous voyez si vous voulez toujours le devenir. Ensuite, on a un deuxième entretien, on voit ce que vous faites et ce que vous voulez faire et vous êtes admis d'emblée. Il n'y a pas de parcours initiatique, c'est pas quelque chose qu'on obtient ou qu'on obtient pas. Donc vous obtenez tout de suite, vous êtes tout de suite école amie des langues. Ce qui veut dire que vous allez mobiliser vos forces pour avancer vers ce qui est votre propre idéal. Alors j'insiste sur le vous ici, parce que je parle là à ces enseignants, ces écoles. Alors, on leur demande de réfléchir justement aux mandats qui leur sont donnés, soit par le conseil scolaire, soit par la province, soit par le gouvernement. Ça dépend du type d'organisation en fonction du pays. Et de voir comment est-ce que leurs objectifs d'école amie des langues s'inscrit dans ce mandat. Alors je vais vous donner un exemple. Certaines écoles veulent, par exemple, impliquer plus les familles. C'est compliqué souvent d'impliquer les familles quand le réseau est très international, quand la communauté est très internationale parce qu'il y a souvent pas la même approche de l'école, de l'enseignement et et les mêmes attentes. Donc en fait, c'est souvent pas facile de les ramener à l'école. Donc l'école à ce moment-là va se poser la question de savoir ok, donc je vais inscrire dans mon mandat de ramener cette année les familles dans le réseau scolaire et je vais voir comment je peux faire ça par le biais des langues. Alors, on a des écoles, par exemple, qui...beaucoup de nos écoles d'ailleurs, développent un système d'ambassadeurs de langues, donc demandent à leurs élèves quelles langues ils parlent et puis leur font passer un petit parcours initiatique pour comment devenir ambassadeur et puis aux soirées parents professeurs par exemple, les élèves sont là à accueillir les parents et à les diriger vers les tables en question, etc. Donc voilà, chacune va inventer des petits moyens, on leur demande pas des choses extraordinaires pour... alors pour une autre école, ça va être pour nous on voudrait... l'objectif par rapport au mandat du conseil scolaire cette année, c'est la littératie. Ok, donc comment inscrire l'école amie des langues dans cet objectif de littératie? Eh bien, ça va être, par exemple, par le biais de la découverte des systèmes d'écriture beaucoup plus large que simplement le système d'écriture que nous connaissons, anglais ou français. Et puis alors on va voir apparaître sur les murs de la classe des caractères chinois, des caractères japonais, coréens, ou bien on va voir des lettres arabes. Les élèves vont comparer le nombre de lettres dans chacun de ces systèmes ou bien la manière dont ils sont répartis, etc. Ou alors, pour une autre école, ça va être les mathématiques. Ok, les mathématiques, eh bien dans ce cas-là, on va aller demander aux élèves quels sont les célèbres mathématiciens qui s'exprimaient dans les langues en question, etc. Donc voilà, c'est tout simple, tu vois. Ces dernières années, il y a eu beaucoup... ils avaient comme mandat des conseils scolaires de combattre le racisme. Et beaucoup ont utilisé l'École amie des langues pour faire ça. Donc ils sont allés dans toutes les langues en question, ils ont été chercher des personnages célèbres, ils les ont mis sur les murs de l'école, ils les ont mis en avant. On a fait... Il y a énormément de racisme qui est basé sur la langue, on en parlait dès le début. J'espère que ça répond à la première partie de ta question. La seconde, quel est mon secret? J'ai pas de secret. Non, je crois que demander quel est ton secret pour mettre des gens ensemble de tous ces horizons différents. Je dois dire que pour nous, pour Ellen-Rose et moi, et puis pour tous ceux qui ont rejoint l'École Amie des langues, donc toi par exemple. On vient d'avoir une conférence de l'École amie des langues très récemment à Hamilton, dans une école Glendale, qui est une école extraordinaire, une école secondaire qui a rassemblé plus de 150 personnes du monde entier, sans compter les élèves nouveaux arrivants qui étaient là, qui faisaient l'accueil, qui participaient à cette conférence, qui interrogeaient qui, etc. Et puis des chercheurs du monde entier, des étudiants du monde entier. Et je pense que c'est la joie d'être ensemble. La joie d'être ensemble et la joie de partager un objectif commun, qui est finalement un objectif de paix, de paix et éduquer pour la paix. Et je pense que ça se résume à ça. Je pense que moi, un exemple qui m'a beaucoup marquée, qui est alors un exemple typiquement français, c'est que les premières écoles bilingues français allemand en France sont nées à la suite de la seconde guerre mondiale sur la frontière franco-allemande, pour justement favoriser un retour à l'amitié. Donc, ça c'est un exemple très fort de l'amitié qui naît de cette différence et de cette volonté de connaître l'autre. Il y a chez chacun des participants de l'École amie des langues, une grande curiosité de l'autre. Dis-moi qui tu es. Moi, quand j'invite des gens à la maison ou n'importe qui d'ailleurs, j'ai envie de savoir qui ils sont. Parle-moi de toi. Je ne vais pas d'abord leur parler de moi. Je ne vais pas leur dire regarde qui je suis, je ne vais pas leur déballer mon cv, je ne vais pas leur déballer... Non, je les invite parce que j'ai envie de les connaître. Dis-moi qui tu es. Et puis de ce dialogue, à force de les écouter, eh bien va naître un désir de se connaître. Moi, je crois dans la connaissance réciproque, cette curiosité qu'on a les uns des autres et le désir d'apprendre les uns des autres. Il n’y a personne qui sait mieux. C'est juste on apprend les uns des autres et ça c'est très fort dans l'École amie des langues. Il n'y a pas de hiérarchie d'école. Non, il n'y a pas d'écoles meilleures que les autres. Il y a juste des personnes qui veulent apprendre. Ça a marché dans ton contexte, ça n'a pas marché dans ton contexte, pourquoi pas? Ah d'accord, il faut peut-être le modifier un petit peu. Et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Qu'est-ce qui marche chez toi? Dis-moi qui tu es et puis ensemble, on va réfléchir à des solutions. Dis-moi quelle est ta conception de l'enseignement? Qu'est-ce qui ne te va pas? Qu'est ce qui te convient? Qu'est-ce que... Voilà, s'écouter. Je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à s'écouter.
Marie-Paule [00:45:11] Donc ce projet ami des langues c'est, tu le dis de façon très éloquente, c'est un projet pour la paix, un projet qui voit les langues comme une ressource dans l'école, dans la vie de chacun, des uns et des autres. Tu as un autre projet également qui là amène les langues au cœur des disciplines et notamment au cœur des mathématiques avec ton projet ESCAPE. On est toujours vers une éducation inclusive, équitable, qui valorise notamment les minorités linguistiques. Que peux-tu nous en dire de cet autre projet, le projet ESCAPE?
Emmanuelle [00:45:45] Oui, alors ce projet il m'est un peu tombé dessus par hasard, je vais dire. C'était en 2018, je crois. Je reçois un coup de fil du professeur Jim Cummins qui me dit « Oh là là, j'ai été contacté par une équipe. Ils ont créé un programme en ligne, je crois, d'enseignement des sciences et des mathématiques multilingues. Est-ce que ça t'intéresse de les rencontrer? » Alors, je dis bah oui, ça m'intéresse beaucoup de les rencontrer, une équipe de Suédois, d'autant plus que moi-même, j'étais déjà en train de travailler sur... en fait, je m'étais déjà rendu compte que vous voyez, quand un nouvel élève arrive dans une école, bien sûr il y a cette question de la langue de l'école qui n'est pas forcément la sienne, mais on réduit trop souvent cette arrivée à cette langue. En fait, il n'y a pas seulement la langue de l'école, il y a toutes les expériences de vie de cette personne, on vient d'en parler longuement, mais il y a aussi un programme scolaire. L'élève, il a été élevé dans un certain programme scolaire et en fonction de ce programme scolaire, il y a des choses qu'il aura apprises et d'autres non. Donc en fait, lui demander, quand il arrive, de résoudre des problèmes qu'il n'aurait même pas abordé dans son école n'aurait aucun sens. De la même manière que de lui demander de résoudre des problèmes qu'il a fait deux ans auparavant n'a pas grand sens non plus parce que j'ai vu beaucoup ça dans les écoles, des enseignants qui me disaient cet élève, il est brillant, il faisait tout bien. Mais en fait, quand j'interrogeais l'élève, l'élève me disait bah oui mais ça, je l'ai déjà fait il y a deux ans dans mon école à moi. Ce que l'enseignant prenait pour une super réussite de cet élève, en fait l'élève était déçu parce qu'il apprenait rien et il se contentait de transposer ce qu'il avait déjà appris et forcément, il réussissait très très bien. Donc je sentais qu'il y avait un décalage très très fort qui était aussi dû à cette méconnaissance des programmes scolaires des pays de provenance des élèves. Et la même chose s'est passée avec mes enfants, par exemple. Donc c'est quelque chose que j'avais vécu de plusieurs manières. À l'époque où j'ai rencontré cette équipe, je travaillais avec Dania Wattar sur les programmes scolaires syriens, ce qui a été pour moi tout un apprentissage d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert avec Dania qu'en fait pour elle aussi, ça a été une surprise, même si elle avait été en Syrie parce que vous savez, les programmes scolaires changent, que les élèves syriens jusqu'à la cinquième classe sont élevés avec des chiffres mathématiques qui sont les chiffres indo-arabes, c'est-à-dire ce ne sont pas les chiffres arabes que nous connaissons, mais des chiffres qui s'écrivent différemment. Ce qui fait que quand un élève arrive en cinquième année de Syrie et qu'on lui demande de faire une opération avec les chiffres arabes, il va probablement pas y arriver, mais pas parce qu'il ne sait pas compter, pas parce qu'il sait pas faire une opération, mais simplement parce qu'il ne connaît pas cette écriture, voyez. Et, il ne va pas vous le dire, il ne va pas vous le dire parce qu'en fait, ça c'est une autre recherche que j'avais fait il y a longtemps, mais les élèves ne contredisent pas l'enseignant, ils ne vont pas lui dire non mais en fait, je n'ai pas appris ce que tu me demandes, j'ai appris autre chose. Donc voilà, je travaillais là-dessus. Et puis donc ça m'a amenée, cette rencontre avec cette équipe de développeurs en fait de programmes m'a amenée à m'intéresser à la question des mathématiques et des sciences, et notamment du fait que les enseignants de mathématiques et de sciences, et plus largement d'ailleurs, considèrent souvent que les mathématiques et les sciences ce sont des domaines qui sont indépendants des langues. Et en fait, c'est totalement faux. Ce sont des domaines qui sont éminemment langagiers et éminemment culturels. On ne fait pas une opération de la même manière en fonction du pays dans lequel on se trouve, même en Europe d'ailleurs. Mais ça va aussi beaucoup plus loin que ça, la manière dont s'est enseigné. Donc on s'est intéressés à cette ressource qui s'appelle Binogi et qui se présente sous la forme de vidéo de 5 à 7 minutes qui présente un sujet. Et la spécificité de cette plateforme, c'est que les élèves peuvent changer la langue de l'écoute. Et alors, ils ne la changent pas forcément en anglais ou en français, mais dans d'autres langues qui sont plutôt des langues comme le dari, comme l'arabe, des langues qu'on ne considère pas forcément dans l'enseignement. Et donc on a voulu savoir, mais quel est l'effet d'une ressource comme celle-là sur l'apprentissage des élèves? Et là c'est rigolo qu'on ait ce balado maintenant parce que j'ai un article qui va sortir d'un jour à l'autre, dont je suis super fière, et qui montre qu'en fait...je vais entrer dans des termes un petit peu techniques, mais en fait donc on a fait travailler les élèves sur cette plateforme et on a regardé la différence entre les élèves dont la langue était l'anglais, donc qui pouvaient regarder en anglais les vidéos, les élèves dont la langue minoritaire était incluse dans la plateforme, par exemple les élèves qui avaient le dari ou l'arabe et les élèves dont la langue minoritaire n'était pas incluse dans la plateforme. Par exemple parler, je sais pas moi, le chinois. Et on a regardé leur degré d'engagement dans cette ressource. Et en fait, je vous le dis très vite, mais le résultat a été que les élèves qui ont passé le plus de temps à travailler les mathématiques et les sciences sur cette ressource devine lesquels ce sont?
Marie-Paule [00:51:13] Ceux dont les langues étaient présentes sur la ressource?
Emmanuelle [00:51:16] Oui, donc pas les anglophones, pas ceux bien sûr dont la langue n'était pas représentée, mais c'est ceux dont la langue était présente sur la ressource. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de voir sa langue dans une ressource pédagogique est déjà extrêmement engageant pour l'élève. Ça ne veut pas dire qu'il va y passer forcément, passer beaucoup de temps dans sa langue, mais que déjà ça, il se sent apprécié, il se sent légitimé, il se sent reconnu et il va passer beaucoup plus de temps à faire des maths et des sciences que les autres. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que si on fait rentrer les langues des élèves dans les ressources d'apprentissage, on va leur permettre de s'investir beaucoup plus dans le matériel scolaire. Et c'est exactement ce qu'on veut. C'est ce que veut chacun des enseignants. Alors ça, c'est une chose. Alors le projet ESCAPE, c'est pas seulement ça, c'est aussi l'étude de tous ces programmes scolaires, de tous ces pays dont proviennent nos élèves et les familles. Alors on a fait la cartographie de, je pense, quatorze pays maintenant, dont la Turquie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, la Syrie, la Chine, la Corée, la Pologne, le Canada évidemment, alors par province, plus l'Ontario que les autres provinces d'ailleurs, mais quand même. Et là on compare. Alors qu'est-ce qu'on compare? On compare les contenus, on compare l'organisation des contenus, on compare le degré de profondeur dans lequel chaque sujet est étudié, on compare la langue dans laquelle s'est enseigné. Vous verrez par exemple qu'au Pakistan, dans un certain nombre de conseils scolaires, la langue d'enseignement, c'est l'anglais, pas tous mais dans un certain nombre. Donc on se permet d'avoir ces surprises. On compare aussi les méthodes d'examens, comment est-ce que les élèves sont évalués, examinés? Et ça c'est très important parce qu'ici, en Ontario, on parle de l'EQAO qui est le test de mathématiques qui est standardisé. Mais en fait, c'est un test qui, depuis un an, est devenu extrêmement digitalisé, avec des choix multiples, etc. Mais si c'est un élève qui arrive d'un pays, par exemple la Chine, où il n'y a plus le droit d'avoir des ordinateurs à l'école, eh bien est-ce qu'il va être capable de le faire, est-ce qu'il va être capable de faire l'EQAO. C'est pas forcément parce qu'il s'y connaît pas en maths, mais c'est simplement parce qu'il ne sera pas capable de... c'est très complexe le système de réponse. Donc voilà, c'est le sujet qui nous anime. Alors j'ai la chance d'être entourée par une équipe absolument fabuleuse. Alors à commencer par les assistants de recherche qui viennent chacun de ces pays, ça c'est très important, si on parlait de connaissances réciproques. Ils arrivent avec ces connaissances et ils font la recherche dans leur langue et ensuite ils l'apportent, ils le comparent, on travaille ensemble. On a eu des heures merveilleuses à travailler ensemble. Et puis Jim, Jim Cummins qui est un co-principal investigateur avec moi sur cette recherche et puis d'autres comme Antoinette Gagné, qui est vraiment très présente, et Alexandre Cavalcante qui est un spécialiste de la didactique des mathématiques qui travaille avec nous ici à OISE. Voilà, j'ai la chance, ce sont des équipes absolument formidables réunissant des post-doc, des doc et avec qui on fait des recherches qui me passionnent, qui nous passionnent. Je pense que... on se rencontre tous les mercredi matin et à chaque fois c'est la joie de se retrouver et qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors on a un site, on le mettra sur le site du CREFO, mais c'est www.escape parce que ESCAPE, c'est Enseigner les SCiences Aux élèves Plurilingues, escapeprojects, projet en anglais avec un s au bout, .ca. On met le plus possible de nos ressources en ligne. Donc tout le monde peut y accéder, voilà. Donc pour nous, la grande question, c'est de savoir maintenant toutes ces ressources qu'on a créées, parce qu'on a aussi tout un pan qui s'adresse aux familles où on explique l'enseignement des sciences et des mathématiques au Canada, aux familles dans leur langue à elles, en comparant avec leurs propres systèmes pour les aider à mieux comprendre et on organise énormément d'ateliers pour ces familles. Donc on en a fait pour toutes les langues, mais on a fait aussi, on a donné un certain nombre d'ateliers qui étaient plus dirigés vers des langues spécifiques. Par exemple, Zara a donné beaucoup d'ateliers en langue persane, donc dari, persan, c'est la même langue, enfin avec des nuances. Ou bien Emre a donné des ateliers en turc pour les familles. Et ce sont des ateliers qui ont énormément, énormément d'impact. Les parents nous disent mais pourquoi est-ce qu'on nous avait jamais dit ça? Donc vraiment, l'atelier est en quelque sorte devenu ma nouvelle méthode de recherche. Par ces ateliers, on réfléchit ensemble avec les enseignants et avec les parents, sur comment mieux soutenir les élèves à l'école et en particulier les élèves plurilingues et les nouveaux arrivants.
Emmanuelle [00:56:46] Merci beaucoup Emmanuelle, très inspirant tous ces projets. On comprend toujours et encore que tu arrives à mobiliser des acteurs dans tous les domaines, mais également que tu es très à l'écoute des histoires de tes collaborateurs, de tes étudiants. Et on retrouve notamment dans tes deux dernières publications que tu as révisées, donc une en collaboration avec Gail Prasad et Nathalie Auger sur Multilingualism and Education. Researchers' Parthways and Perspectives chez Cambridge. Et un autre ouvrage que tu as fait avec Nathalie Auger sur Défis et richesses des classes multilingues. Construire des ponts entre les cultures. Tu nous parles de cette importance d'une éducation inclusive, d'être à l'écoute. Comment l'ensemble de ces collaborations participe à tes positionnements, voire même tes repositionnements de recherche?
Emmanuelle [00:57:36] Alors je ne renie rien de ce que j'ai écrit, ça c'est important de le dire. J'aime beaucoup parfois me relire et justement voir cette évolution parce que tu as raison de le dire, ces livres et ces articles représentent aussi un cheminement, mon propre cheminement, mon cheminement personnel, un cheminement de recherche. On parlait des projets ESCAPE et là on prépare un livre là-dessus sur ces comparaisons de programmes scolaires qui me passionne, qui j'espère, sortira dans le courant de l'année prochaine. Mais ça, on verra. Alors ce qui, je pense, différencie ces ouvrages, c'est d'une part leur lectorat. Le livre dont tu as parlé que j'ai écrit avec Nathalie Auger et qui s'appelle Défis et richesses des classes multilingues est un livre que nous avons écrit pour répondre aux questionnements des enseignants, des familles, des élèves parce qu'on s'était aperçu, toutes les deux, qu'il y avait énormément de questions récurrentes qui nous étaient posées et auxquelles on était amené à répondre ponctuellement. Donc on a mis tout ça dans un ouvrage qui est assez court, qui fait 140 pages et à la fin on a regroupé toutes ces questions et chacun peut aller voir ces questions et y trouver les réponses ou plutôt des pistes de réponses, parce que c'est jamais des réponses absolues, le monde change, avec des QR codes qui ramènent à des projets en fonction de leurs propres questionnements. Donc c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, aux enseignants. L'éditeur a été très dur avec nous parce qu'elle voulait vraiment pas qu'on utilise de jargon, etc. Donc elle soulignait, elle écrivait je comprends rien, fallait qu'on réécrive. Donc voilà, on a passé beaucoup d'heures à essayer de travailler là-dessus. Le livre, qui en fait est le livre de Gail et Nathalie, que j'ai rejoint plus tard, est un très très beau livre qui raconte le parcours de 37, il me semble, chercheurs éminents internationaux et qui parlent de leur positionnement par rapport à la recherche et à l'enseignement sur la base de ce qu'ils ont vécu de manière individuelle. Il y a quelques chapitres avec des photos aussi, des photos de leur enfance, je vois Ofélia Garcia par exemple, ou bien Jean-Claude Beacco pour les Français ou même toi Marie-Paule. C'est un livre que je recommanderais plutôt pour les enseignants-chercheurs et pour les universités, mais qui est ouvert à tous, qui se lit très facilement aussi. Donc je pense que le lectorat, c'est vraiment la différence. Voix et visage du français en Ontario, celui-là, il est vraiment je pense que ce serait bien, je serais heureuse de savoir que, par exemple, les décideurs le lisent, les ministères, les décideurs parce que je pense que c'est important quand on travaille sur le global, sur des lois, sur des attributions de fonds, etc. de pouvoir aussi voir la personne derrière chacune des personnes qui travaillent, les petites fourmis qui travaillent ou abeilles, c'est peut-être plus joli, à la mise en place de la ruche, voilà et qui créent cette petite alcôve. J'aimerais bien que les décideurs puissent le lire. Donc je dirais que oui, c'est des perspectives différentes. On peut prendre l'image du musée, quand on voit une statue et qu'on la regarde sous un angle différent, on va voir quelque chose de différent, on va étudier un aspect différent. En ce moment, je suis en train de lire un roman merveilleux, ça s'appelle Les yeux de Mona, tu l'as peut-être lu, où à chaque fois il regarde avec un enfant une œuvre d'art au musée du Louvre. Bref, tout ça pour dire qu'à chaque fois, on prend une perspective différente sur un objet qui est toujours le même, qui est l'éducation en général. Donc c'est ce qui rassemble toutes mes publications, c'est que c'est toujours autour de l'éducation mais vue de perspectives qui s'ouvrent à moi au fur et à mesure de mes recherches. C'est en cela que mon parcours influence ma recherche, c'est qu'à chaque fois, une nouvelle recherche m'ouvre une porte sur un nouveau questionnement. En fait, c'est quelque chose qu'on dit souvent à nos étudiants de doctorat, on leur dit la manière naïve de voir la recherche c'est de penser, il y a une question et on va trouver une réponse. En général, il y a une question et puis au moment de la conclusion, eh bien on arrive avec trois ou quatre questions supplémentaires qu'on va pouvoir mener dans des recherches subséquentes. Donc voilà, c'est vraiment ça. Chaque recherche m'ouvre à de nouveaux questionnements, à de nouvelles questions, et m'amène à créer de nouveaux projets et à ouvrir de nouvelles voies. Donc la voie de la recherche c'est à la fois épuisant, parce que ça ne s'arrête jamais, enthousiasmant, parce que c'est fait de découvertes extraordinaires, décourageant, parce que parfois on se retrouve tout seul en se disant j'arrive à rien, c'est épouvantable et puis nourrissant parce que c'est fait de rencontres toujours nouvelles, toujours renouvelées, qui nous permettent de nous renouveler nous mêmes.
Marie-Paule [01:03:34] Quel beau message pour terminer ce podcast Emmanuelle. Un grand merci de nous avoir inspirés et de nous avoir montré que, aussi bien seul qu'en collaboration, on peut tous participer à notre niveau à une éducation à la paix et à une éducation plus inclusive, toujours pour valoriser les minorités linguistiques, peu importe où on est dans le monde. Donc merci beaucoup pour cet échange si inspirant. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à retrouver Emmanuelle en tant qu'animatrice dans plusieurs autres balado du CREFO et à bientôt!
Joey [01:04:09] Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo.oise@utoronto.ca