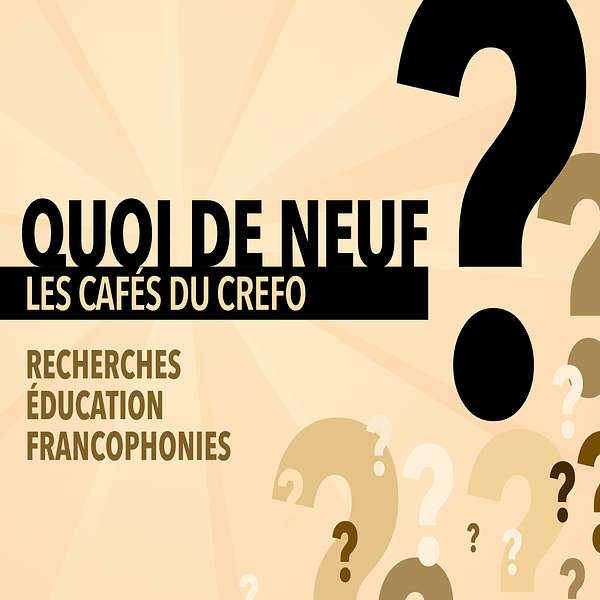
Quoi de neuf ?
Quoi de neuf ?
Réparer les mots, guérir les mondes : Entretien avec Elatiana Razafimandimbimanana
Dans cet episode, Emmanuelle Le Pichon, directrice du CREFO, rencontre Elatiana Razafimandimbimanana, maîtresse de conférences à l’Université de la Nouvelle Calédonie.
Elatiana Razafimandimbimanana est maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches (HDR), en sciences du langage à l’Université de la Nouvelle Calédonie et membre du centre de recherche ERALO (qui signifie « chante » en langue nengone, l’une des 40 langues kanak de la Nouvelle Calédonie). Elle puise dans les approches pluriartistiques dans le but de contribuer à la valorisation de la diversité linguistique et à une meilleure reconnaissance des minorités linguistiques en tant qu'héritières et productrices de savoirs. Se définissant comme « chercheure nomade », ses projets de recherche-création se construisent à travers la mobilité géographique et la pluralité disciplinaire.
Façonné par la mobilité, le parcours personnel et professionnel d’Elatiana l’amène à concevoir les langues comme étant des espaces sociaux où se négocient des rapports de force. À travers cette approche sociale des langues, elle explore les dynamiques plurilingues, sentiments d’appartenance, mises en altérité, idéologies dominantes et imaginaires. Les projets qu’elle développe en Nouvelle-Calédonie – et ailleurs – ont ainsi pour objectif transversal de participer à une meilleure reconnaissance sociale des personnes minorées ou invisibilisées en raison de leurs langues. De ce fait, les notions de « circulation des savoirs » et de « réparation épistémique » font partie intégrante de ses pratiques. Il en résulte aussi une articulation étroite entre formation, recherche scientifique et médiations pluriartistiques, soit autant de chemins pour construire des savoirs.
Joey 00:00
Dans cet épisode, Emmanuelle Le Pichon, directrice du CREFO rencontre Elatiana Razafimandimbimanana, maîtresse de conférence à l'Université de la Nouvelle Calédonie.
Elatiana 00:32
Vous imaginez bien que quand on pense qu'on n'est pas légitime en tant qu'être social, c'est-à-dire quand on ne se sent pas légitime à appartenir à notre groupe fondateur premier, allez construire des connaissances académiques. On se dit ben j'ai pas ce qu'il faut ou je ne suis pas légitime pour le faire.
Joey 00:44
Bienvenue à Quoi de neuf !
Emmanuelle 00:46
Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast du CREFO Quoi deux neuf? et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle Elatiana Razafimandimbimanana, maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches en sciences du langage à l'Université de la Nouvelle Calédonie. Bonjour Elatiana!
Elatiana 01:09
Bozu, bonjour!
Emmanuelle 01:09
Alors pour moi c'est le soir, pour toi c'est le matin. Alors Elatiana, tu te définis comme une chercheure nomade explorant des dynamiques plurilingues à travers une approche que tu veux profondément ancrée dans la réparation épistémique, la création artistique et la circulation des savoirs. Tu es membre de l'Unité de recherche en sciences humaines et sociales qui œuvre pour la valorisation de la diversité linguistique et de la réussite éducative. Donc avec toi, nous allons parler de francophonies, toujours au pluriel, de diversité linguistique, d'éducation et de la manière dont l'art peut devenir un outil de médiation et de transformation sociale. Curieusement, nous nous connaissons depuis au moins 15 ans puisque je faisais ma thèse dans le labo où tu travaillais à l'époque. Mais étant moi-même une nomade, nos chemins se sont rarement croisés et ce sont pourtant nos intérêts scientifiques communs qui nous ont réunis récemment, d'abord lors d'un symposium à Chypre il y a un an. Et enfin, en ligne quand tu as accepté de travailler avec mes étudiantes pour un de mes cours. Et d'ailleurs, ça a été une collaboration fascinante que j'espère nous aurons l'occasion de continuer. Et puis au Japon, il y a quelques mois. Et ces rencontres m'ont permis de mieux découvrir ton travail et surtout de vouloir en faire profiter un plus grand nombre et notamment à travers ce podcast. Alors merci Elatiana d'avoir accepté mon invitation!
Elatiana 02:50
Merci Emmanuelle pour l'invitation. Je profite de cette introduction pour aussi dire à quel point j'ai le plaisir d'avoir découvert en toi la possibilité d'allier à la fois la productivité scientifique et une profonde humanité.
Emmanuelle 03:07
Merci! Alors Elatiana, tu te définis comme une chercheure nomade. Qu'est-ce que ça signifie pour toi et comment est-ce que ton parcours personnel a façonné ton rapport aux langues et à ton travail, à ta recherche.
Elatiana 03:22
Oui, c'est une question qui est vraiment importante pour moi et que j'ai peu l'occasion d'expliciter. Donc je te remercie de me la proposer. En fait, je me définis comme chercheure nomade de façon réflexive lorsque j'essaie d'optimiser mon parcours marqué par des mobilités qu'on appelle, de façon commune, des migrations. Mais je préfère parler de mobilité parce que je trouve que c'est un terme qui est moins chargé négativement, qui est moins associé à des lectures médiatiques, politiques dévalorisantes. Alors que mobilité, on peut y voir à la fois de la volonté mais surtout du mouvement, quelle que soit la part, je dirais, de la personne ou des entités en question. Donc moi, j'ai un parcours qui est marqué, qui a été construit, déconstruit par des mobilités, des mobilités à la fois voulues, familiales, avec des projets de réussite, des projets d'amélioration, mais forcément une mobilité qui est motivée par un projet de réussite ailleurs. Ça veut aussi dire une volonté de quitter l'instant, l'ici, l'immédiat et donc peut-être de fuir. Et derrière ça, il y a forcément des histoires qui sont douloureuses, qui sont difficiles. Et quand on dit qu'on a un parcours construit, déconstruit par la mobilité, c'est bien ça que je veux essayer de souligner. Et je parle de nomadisme parce que, encore une fois, je me saisis d'une terminologie qui est moins circulante, qui existe moins et dont on a moins l'habitude d'entendre, d'utiliser. Ça me permet d'avoir un espace de créativité, un espace d'agentivité, pour dire autrement les choses, un espace d'action. Et par nomadisme, je souhaite mettre en avant que bien qu'on ait pu vivre des migrations, des mobilités qui n'ont pas toujours été choisies, qui n'ont pas toujours été effectuées dans des contextes faciles, eh bien on peut en faire un mode de vie, un mode de pensée et une façon d'être comme le font les nomades. Et donc c'est vraiment assez récemment que je me suis saisi de cette terminologie pour me définir, pour essayer aussi, tu évoquais Emmanuelle les étudiantes et étudiants et donc c'est aussi pour essayer de donner à voir des exemples humains positifs et transformants des vécus qui ne sont pas toujours faciles en identité pleinement assumée avec ses complexités.
Emmanuelle 05:56
C'est magnifique, dis-donc on commence fort. Alors on entend dans tes mots, il y a tout un parcours qui résonne et notamment un parcours scientifique. Et je sais que tu as commencé par la didactique du plurilinguisme qui t'a plus tard menée à la sociolinguistique. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours, pourquoi de l'un à l'autre ou l'un et l'autre, comment tu te situes?
Elatiana 06:26
Oui, c'est vrai que c'est difficile d'essayer de mettre de l'ordre dans un parcours qui parfois a été fait par défaut. Je pense au choix d'études. Parfois on sait pas trop quand on a 16-17 ans et qu'il faut se projeter dans des études supérieures et qu'on se dit mais il faut aussi que je choisisse un métier et on se dit ce métier, ça veut dire que c'est ce que je vais faire tous les jours pendant le restant de ma vie. Ça paraît comme une condamnation quand on a devant nous d'autres préoccupations. Et donc parfois on fait des choix par défaut, pour suivre les amis ou parce qu'on se dit c'est peut-être la matière scolaire que je réussis la plus et moins par vocation, au sens où on a quelque chose qui nous habite. Donc c'est difficile de reconstituer de façon linéaire et clair les choses parce que sur le moment, on est bien consciente que c'était pas du tout clair et linéaire. Mais oui, par rapport à mes choix d'orientation, moi j'ai effectué... ça va m'obliger à revenir un petit peu sur le parcours scolaire carrément. J'ai effectué ma scolarité sur différents continents, pour dire vite. La première enfance, donc la première expérience scolaire, elle s'est faite à Madagascar, dans un contexte postcolonial, francophone et multilingue. Ensuite, je migre, je fais une mobilité familiale au Kenya où je découvre un autre contexte francophone qui devient minoritaire et où je vais aussi faire une mobilité à l'intérieur de différents systèmes scolaires puisque je vais changer de langue de scolarisation. Je vais intégrer l'école britannique postcoloniale kényane. Et là je change de langue de scolarisation puisque je vais apprendre l'anglais. Donc vous voyez que déjà, avec ces deux étapes initiales, je vais découvrir la didactique du plurilinguisme par l'expérience, par l'épreuve et je vais vivre la sociolinguistique, au sens la place des langues dans la construction des rapports de pouvoir dans une société, à un âge qui est tout à fait jeune. Mais je pense sincèrement que s'il n'est pas exceptionnel, je pense qu'on vit tous ces expériences sociolinguistiques et didactiques. Simplement maintenant que je suis spécialisée dans ces champs, je me rends compte à quel point enfant j'étais, on va dire, sensibilisée de façon amplifiée aux questions qui traversent ces deux domaines. Et si je poursuis rapidement mon parcours scolaire, au milieu du cycle primaire, on fait une nouvelle mobilité vers le Canada francophone au Québec. Et donc là, je redécouvre le français langue de scolarisation. Je suis inscrite en classe d'accueil et je réapprends le français. Donc vous voyez que la didactique et la sociolinguistique sont des expériences motrices de la chercheure, de l'enseignante que je suis aujourd'hui. Et avant de finir l'école secondaire au Québec, je vais faire une mobilité, cette fois-ci individuelle et volontaire, vers l'Ontario où je découvre une francophonie en situation minoritaire et toutes les complexités, tous les enjeux socio-identitaires, politiques, géographiques qui se greffent à ça puisque je suis inscrite à l'école De la Salle, qui est une école francophone à Ottawa. Et avant d'avoir le diplôme d'école secondaire, je fais de nouveau une mobilité individuelle, forte de mes 17 ans pensant que j'avais tout compris à la vie et que je pouvais mener tous mes projets toute seule, le migre, je bouge vers la France continentale et j'atterris en Bretagne. Donc autre situation linguistique plurilingue extrêmement complexe. Donc vous voyez que voilà, c'est un parcours qui est un peu prédestiné aux questions de langue et de société parce que c'est ce que j'ai voulu aussi essayer d'optimiser dans mon parcours professionnel.
Emmanuelle 10:58
Et bien c'est un point commun supplémentaire puisque moi je suis née en Bretagne. Voilà. Alors nous avons un autre point commun, c'est le fait que nous sommes toutes les deux des mamans. Et en tant que maman, c'est pas simplement toi qui as été scolarisée, mais tes enfants aussi et notamment tu as travaillé sur la question des langues en famille et de la transmission intergénérationnelle. C'est quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. Et quels sont les principaux enseignements que tu en tires? Et je dirais peut-être même, si je peux me permettre, par rapport au contexte canadien que tu connais bien, notamment le contexte québécois, quelles seraient les peut-être pas recommandations mais peut-être conclusions que tu tires de cette recherche que tu as faite là-bas par rapport à ça, tu vois en tant que contexte postcolonial et toi avec ton parcours migratoire, etc.
Elatiana 12:03
La question, elle est piégeuse Emmanuelle, je visualise un drapeau rouge que tu agites et moi, il y a plein d'idées qui fusent et je me dis bon, quelle direction je prends? Est-ce que je fonce? Mais elle est tout à fait pertinente dans le sens où il faut qu'on s'y attelle à cette question de la transmission intergénérationnelle. Alors transmission, moi je vais y mettre cette idée de ressources qu'on voudrait partager avec les jeunes, les enfants dont on est responsable légalement. Transmission n'est pas pour moi uniquement dans le sens d'une émission unilatérale des choses mais bien d'un héritage qu'on choisit de léguer, de partager avec les plus jeunes. Donc les travaux que j'ai pu mener autour de ces questions en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, je les ai effectués avec Véronique Fillol qui est la première sociolinguiste ayant pu entamer des travaux dédiés au plurilinguisme et à l'école plurilingue sur l'archipel dans le Pacifique Sud et dans nos travaux qui ont mis au cœur du dispositif de recherche la parole, la réflexion et le vécu des étudiants, étudiantes de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, dans ces travaux on a - enfin je vais dire « je » puisque je veux pas prétendre parler pour Véronique - mais moi j'ai découvert quelque chose d'extrêmement sensible, c'est-à-dire que j'ai eu affaire à un public estudiantin conscient des ressources qui n'ont pas été transmises, des ressources linguistiques, culturelles, patrimoniales, symboliques, identitaires, épistémiques, qui n'ont pas été transmises. Et dans cette non transmission, il y a également eu absence d'explication par, je dirais, les espaces institutionnels éducatifs ou en tout cas une transmission qui n'est pas suffisamment marquante, valorisante pour permettre aux étudiants, étudiantes de se dire OK, j'ai pas reçu ces ressources, mais c'est pas grave, je sais pourquoi et je sais maintenant ce que je veux faire de cette absence de transmission. Donc moi, j'ai constaté la non transmission et surtout des besoins de sens, des besoins chez les étudiants, étudiantes de comprendre pourquoi. J'ai également été très sensible à un sentiment omniprésent d'illégitimité. Pour dire les choses de façon plus concrète, je vais donner l'exemple d'un étudiant qui va dire « Moi, je suis de l'île de Lifou où la langue principale c'est le drehu. Je ne parle pas drehu et donc je me sens illégitime en tant que personne originaire de Lifou. En gros, qui suis-je ». Et ce sentiment d'illégitimité, j'ai trouvé que c'était extrêmement néfaste dans tous les pans de la vie et que c'était néfaste également dans l'acquisition, dans le cheminement vers la construction de savoirs académiques. Vous imaginez bien que quand on pense qu'on n'est pas légitime en tant qu'être social, c'est-à-dire quand on se sent pas légitime à appartenir à notre groupe fondateur premier, aller construire des connaissances académiques, on se dit ben j'ai pas ce qu'il faut ou je ne suis pas légitime pour le faire ou pire, peut-être que ça va me rendre encore plus illégitime parce que je vais aller chercher des connaissances institutionnelles venues d'ailleurs ou perçues comme telles et donc je vais encore plus m'éloigner de mon groupe d'appartenance premier. Donc vous voyez que cette question de transmission, elle est devenue une question d'existence plus qu'une question linguistique. Donc on revient aux enjeux de la sociolinguistique, de la didactique du plurilinguisme où vraiment je me suis dit d'accord, je vais essayer de voir comment, dans ma pratique d'enseignante, de formatrice, je peux essayer d'accompagner les étudiants, étudiantes en Océanie non pas vers une réussite, une excellence académique, mais vers un meilleur rapport social à l'excellence académique. Voyez, j'ai déplacé un petit peu les choses en me disant plus que de me dire - et là je parle de posture - plus que de me dire je viens, je vais transmettre, déverser, donner des connaissances, je vais estimer et c'est sincère, je me suis dit j'estime que je n'ai pas ce qu'il faut pour leur permettre de mieux vivre l'Océanie. Pour mieux vivre l'Océanie, ce sont les étudiants et étudiantes qui savent ce qu'il faut. Donc ce n'est pas moi qui vais leur enseigner la vie. Par contre mon rôle, et c'est peut-être un privilège, ce serait de construire des espaces de formation au sein de l'université où les étudiants et étudiantes pourront reconstruire un sentiment de légitimité, reconstruire un sentiment de confiance en soi. Ça, je pourrais le faire et c'est là la réparation épistémique. C'est ça la mise en confiance, la valorisation de la diversité. Ce n'est pas pour valoriser les langues en elles-mêmes pour elles-mêmes, c'est pour valoriser le fait que dans tout espace social, il y a une diversité de maîtrise, de sentiment d'aisance dans les langues. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de mettre en place, à la fois dans les dispositifs de recherche, dans les méthodes de recherche et dans les espaces de formation. Donc, voilà. Pour terminer, dans les dispositifs de recherche qu'est-ce que ça donne cette approche qui se veut valorisante pour les participants et participantes? Eh bien plutôt que d'arriver avec des questionnaires ou imposer un échange sous forme, on va dire, d'entretien dirigé, on va construire ensemble des espaces d'échange. Ou encore je vais permettre aux étudiants et étudiantes d'imaginer et de concevoir les outils d'enquête selon leurs connaissances, selon leur réseau de compétences et selon leur réseau de connaissances sociales. Donc on élabore ensemble et ça vous voyez que ça permet une montée en puissance. Ça permet aux étudiants et étudiants de se dire bah oui, j'ai des connaissances, j'ai des ressources, j'ai des compétences, l'enseignante me demande de les déployer. Eh ben je peux le faire. Est-ce que je veux le faire peut-être? Oui, ça va me permettre de comprendre pourquoi moi on m'a pas transmis la langue et qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien. Peut-être qu'il y en a d'autres, voyez, c'est les placer au cœur du dispositif et j'apprends.
Emmanuelle 19:41
C'est magnifique! Alors oui, tu apprends. Moi, je me reconnais dans beaucoup de ce que tu viens d'expliquer de manière extrêmement éloquente. Alors moi, quand j'avais lu tes travaux, j'avais plus lu des choses sur ce que tu appelais la justice épistémique. Mais là tu parles de réparation épistémique. Donc quelle différence est-ce que tu fais entre les deux termes? Est-ce que l'un t'a mené à l'autre ou est-ce qu'ils sont interchangeables?
Elatiana 20:09
Alors la justice épistémique, c'est un axe de travail que je dois à Cécile Goï, une collègue de l'Université de tours, qui était également dans mon jury d'habilitation. Et lorsqu'elle a lu la synthèse pour présenter rapidement au public - la consigne nationale en France pour l'habilitation à diriger des recherches demande à ce qu'on fasse un retour réflexif sur nos années en exercice et qu'on puisse dégager les principaux volets structurants et ensuite, qu'on puisse aussi donner des indications sur les directions scientifiques qu'on souhaite dessiner. Et lorsqu'elle a lu le sujet de synthèse dans lequel je fais part de ces retours réflexifs, elle me pose la question en soutenance en se disant que ce que j'essayais de dire et de structurer de façon réflexive, lui faisait beaucoup penser à cette notion de justice épistémique. C'est-à-dire une manière de valoriser, de donner à voir la valeur de groupes sociaux ou de personnes qui détiennent des savoirs mais qui, en raison de caractéristiques racialisées ou socioéconomiques ou encore chromatiques, se voient refuser le statut de personne sachante. Elle se disait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la justice épistémique dans ce que tu dis et dans ce que tu essaies de faire. Ma première réaction était plutôt réticente. Je lui ai dit en soutenance c'est vrai qu'il y a quelque chose d'évident autour des savoirs et donc de l'épistémique par contre, je ne suis pas à l'aise avec la notion de justice parce que je ne me considère pas et je ne souhaite pas me construire en tant que justicière. Je voyais toujours cette image des juges qui se doivent d'être neutres, impersonnels et qui doivent uniquement incarner les textes de loi, donc ça me parlait pas du tout. Donc j'ai cheminé, j'ai lu énormément sur cette notion de justice épistémique et puis il y a quelque chose qui a fait tilt. Dans la découverte de la littérature autour de la justice épistémique, j'ai vu que des chercheures afro-américaines avaient énormément contribué à la diffusion de la notion, mais que c'est une autre chercheure, Miranda Fricker, qui a été elle la plus citée. Donc je me suis dit c'est marrant, il y a une injustice dans la justice épistémique, selon les lectures qu'on va prendre. Et j'ai cheminé en essayant de voir dans quelle mesure la justice épistémique s'appliquait au projet qu'on menait ici, à la fois dans la recherche et la formation. Je me suis plutôt dirigée vers la réparation parce que je suis en contexte postcolonial. On a récemment été confronté à une situation insurrectionnelle, qui n'est pas close. Et je vois bien que les erreurs de l'histoire ne sont pas pleinement reconnues et que pour essayer d'avancer avec les erreurs de l'histoire, afin de ne pas les répéter, et bien la réparation permet de rendre un petit peu justice au sens rendre la place aux personnes qui ont souvent été niées, voire exclues, des espaces de production de savoir.
Emmanuelle 24:04
C'est très Intéressant. Ici effectivement, on parle de réparation, mais on parle aussi de réconciliation. Est-ce que c'est un concept que tu as envisagé où tu trouves difficile? Il a des difficultés à s'imposer. Il a été très utilisé pendant ces quinze dernières années, mais il fait aussi référence à un espace de diversité, de tensions et d'erreurs de l'histoire comme tu veux le dire et comme tu en parles et de soucis de réparation.
Elatiana 24:33
C'est vrai que la réconciliation est une notion ou une problématique qui a été largement mobilisée au Canada et en Amérique du Nord. C'est toujours là autour, je dirais, des faisceaux de notions avec lesquelles j'essaie de travailler, mais je pense que je me garde de m'en emparer parce que, comme tous les autres termes que j'évite, c'est un terme qui est déjà saturé, qui est déjà très très chargé et qui est presque réservé, je dirais, au contexte nord-américain et donc j'ai énormément de mal à l'importer ici. J'essaie aussi, dans cette volonté de réparation épistémique, j'essaie de voir quelles sont les manières de dire les choses en Océanie qui n'ont pas été publiées, qui n'ont pas été transcrites, qui n'ont pas été théorisées scientifiquement, mais qui existent, qui sont opératoires et qui peuvent faire avancer nos compréhensions du monde. Donc j'essaie aussi de réparer les choses à ce niveau un peu plus global, en allant voir des personnes qui ne sont pas détentrices des diplômes, en allant voir des personnes qui ne vont pas écrire ou lire des travaux scientifiques mais qui sont dépositaires de savoir, qui sont dépositaires de mots, de façons de dire les choses et qui nous permettraient à nous d'avancer. Donc j'essaie de créer un dialogue dans ce sens-là plutôt que d'à chaque fois importer parce que dans les erreurs de l'histoire, j'inclus aussi des importations qui ont été vécues comme des impositions de manière de penser.
Emmanuelle 26:30
Alors, il me semble que dans tout ce travail qu'on commence à saisir, qui est absolument passionnant et qui nous donne envie d'en connaître plus, je pense que l'un des outils de médiation - est-ce que médiation est encore le bon terme maintenant, je me méfie - c'est l'art. Et tu as mené des projets passionnants qui mêlent art et recherche comme le Street Art, en particulier autour des micro-agressions linguistiques. Tu as même une exposition qui, je crois, s'est intitulée L'Interculturel en vie et en classe. Donc parle-nous de cette forme de médiation et en quoi l'art a pu jouer un rôle dans la sensibilisation aux enjeux linguistiques, mais on a bien compris que c'est beaucoup plus que linguistique, que ce sont des enjeux socio-historiques profonds.
Elatiana 27:29
Je pense vraiment que la recherche scientifique est un art, est un processus artistique. Je le dis aujourd'hui de façon beaucoup plus claire, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours habitée. La recherche scientifique est un processus artistique pour moi, parce que c'est l'être humain qui construit. C'est l'être humain qui fabrique les savoirs. C'est l'être humain qui dit, qui nomme, qui théorise et qui va transformer des expériences de terrain, des observations sensorielles en connaissance. Donc si ce n'est pas une transformation artistique, je ne sais pas ce que c'est l'art. Vous voyez que l'artiste, au sens convenu, va transformer des objets en un autre objet ou en concept, ou va transformer des idées en objet ou en œuvre, bien je trouve que la recherche, on est dans la même dynamique de transformer ce qu'on observe en sociétés, en connaissances abstraites, en livres, en formations. Donc on fait quelque chose de presque moins palpable. C'est-à-dire qu'on va rendre invisible ce qui nous entoure, c'est un processus artistique pour moi. Mais évidemment, en disant ça, ça peut paraître provocateur parce qu'on se dit mais quand même, si on fabrique, ça veut dire qu'on peut fabuler, qu'on va toucher la fiction et les chercheurs, non non non, il faut que ce soit la vérité qu'on fabrique. Donc oui, ça peut être provocateur, mais je pense que c'est plutôt un aveu d'humilité de se dire qu'on fabrique les connaissances, on fabrique le savoir. Ça veut aussi dire que nous en sommes responsables. C'est nous qui disons que ce qu'on a vu c'est ça et ça s'appelle comme ça. Donc c'est vraiment un acte de responsabilisation. Alors la place de l'art pour moi, elle est, je dirais, de deux sortes. Elle est à la fois un espace ou un levier de sensibilisation, comme tu l'as dit, vis-à-vis du public sur des enjeux qui nous semblent importants, par exemple les microagressions linguistiques. Mais là, c'est aussi pour moi un moyen humain et réparateur toujours, un moyen valorisant pour permettre aux personnes avec lesquelles on effectue des projets de recherche de se sentir légitimes, de se sentir en capacité et de se sentir en, je dirais, en puissance intellectuelle. Et ça a commencé par mon projet de thèse au Canada justement auprès d'enfants qui sont inscrits, inscrites dans les classes d'accueil d'une école montréalaise et avec ces enfants plurilingues, mais qu'on a appelé allophones, c'est-à-dire dont on a enlevé la reconnaissance de compétences plurilingues, je ne souhaitais pas leur imposer l'emploi du français ou de l'anglais ou du langage articulé pour pouvoir m'exprimer comment les enfants vivaient leurs identités, leurs sentiments d'appartenance parce que j'explorais les constructions, les reconstructions de leurs sentiments d'appartenance, peu de temps après leur arrivée en classe d'accueil. Et donc je leur proposais de se dessiner à l'école. Vous voyez que le dessin, l'art, est arrivé comme un médium de production de sens, de production, de compréhension de soi. Donc c'était un levier stratégique, mais c'était aussi une manière pour moi de faire sentir aux enfants que bien qu'ils ne pensent pas maîtriser la langue de scolarisation ou une langue officielle commune avec moi et bien ils étaient et elles étaient tout à fait à même de produire quelque chose de très riche et de très complexe. Donc ça a commencé par ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, pour répondre à la question, l'art sert à la fois de levier pour agir auprès de la société, mais aussi comme espace pour travailler avec les participants et participantes au projet de recherche.
Emmanuelle 32:17
Alors tu l'utilises beaucoup, si j'ai bien compris, dans tes projets, mais aussi dans la formation des enseignants et la pédagogie du plurilinguisme. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu fais, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, au sein de ton université avec tes étudiants en formation?
Elatiana 32:40
Je vous disais tout à l'heure que lorsque je suis arrivée, j'ai été amenée et j'ai voulu, j'ai accepté de redéfinir mon rôle en tant qu'enseignante. Parmi les expériences qui ont déclenché cette révision totale de ma propre posture, de mes propres pratiques, c'est la prise de conscience de l'importance des arts en Océanie. J'ai pu voir à quel point les étudiants et étudiantes étaient extrêmement à l'aise avec des pratiques pluriartistiques. Donc ça se manifestait par exemple par, avant le début d'un cours, je vois une étudiante qui tapote sur la table en rythme et un rythme qui est hyper entraînant. Donc c'est pas juste le mouvement nerveux qu'on peut avoir, c'est vraiment un rythme. Je vais également être attentive au fait que sur les bancs à l'université, sur les marches, dans les cahiers des étudiants et étudiantes, je vois des dessins. Alors c'est pas des gribouillis, ce sont des dessins, du graphisme. Je vais également observer que beaucoup d'étudiants et étudiantes font des spectacles lorsque je participe à des événements culturels. Donc j'observe, je prends conscience de la place omniprésente des arts dans les pratiques de vie, dans les pratiques sociales et je vois à quel point c'est épanouissant. Mais avec cette constatation, j'éprouve un regret profond. Et ça c'est dès mes premières semaines en poste ici en 2016, je partage un profond sentiment de regret parce que dès lors où les étudiants étudiantes traversent le seuil des classes, ça disparaît. On n'a plus que le langage articulé, on n'a plus que cette imposition du français standard, de l'écriture et quelque chose de très aliénant et en contexte postcolonial pour moi, c'est pesant. Pour moi, c'est dérangeant. Donc, je vais réellement faire un acte de révision profonde de mes pratiques où je cherche à intégrer les compétences pluriartistiques dans l'intégralité de mes cours pour essayer encore une fois de valoriser les compétences, de m'en servir comme levier didactique et puis pour réparer, encore une fois, ces fameux rapports aux espaces institutionnels. Donc un exemple puisque tu souhaitais avoir un exemple concret, je vais prendre un cours qui a priori ne se prête pas à la pratique artistique. J'avais un cours qui s'intitulait « Les théories de l'apprentissage ». Il s'agissait ici de parcourir l'ensemble des théories qui ont marqué les sciences éducatives. Donc ça va du conditionnement, le chien de Pavlov jusqu'au socioconstructivisme. Et lors des évaluations, je me suis dit allez, je tente le coup. Je ne vais pas demander de définir quelles sont les grandes théories, je vais plutôt demander de dessiner. Et donc je demande dans les consignes d'évaluation, dessiner par exemple ce qu'est le conditionnement, dessiner le socioconstructivisme. Et puisqu'il faut quand même de l'écriture, on est en contexte académique, il faut développer ses compétences, je demande aux étudiants et étudiantes de décrire leurs dessins. Donc vous voyez que c'est une médiation. C'est une pédagogie un peu détournée et là j'ai d'excellents résultats. Non seulement les dessins sont très éloquents, mais en plus les écrits sont particulièrement structurés, sont limpides et m'aident à comprendre les dessins. Je découvre aussi que les dessins vont regrouper à la fois des références visuelles aux connaissances théoriques, mais aussi aux pratiques culturelles océaniennes. Je vais voir des flèches faîtières, des cases kanaks, des éléments de la nature. Et là, je me dis il y a quelque chose à poursuivre. Voilà un exemple très concret.
Emmanuelle 37:27
Magnifique. Tu me fais rêver et je pense que tu vas me faire réviser un certain nombre de mes évaluations. Malheureusement, le temps avance parce que tu pourrais nous parler, on pourrait parler pendant des heures. Moi qui interromps, d'habitude tout le temps, là je ne suis qu'oreille. Alors je dois maintenant me tourner vers les perspectives et tes engagements. Nous savons déjà que tu es une personne engagée. Je pense que c'est quelque chose qui te définit aussi. Je voudrais que tu nous dises un peu quels sont les projets qui t'enthousiasment actuellement. Et puis, puisque tu as réveillé en nous une soif de plus, quels sont les écrits que nous pourrions lire si on devait commencer quelque part.
Elatiana 38:16
Merci Emmanuelle pour cette question. J'avais vraiment envie de partager les engagements et puis des perspectives avec vous parce qu'il est vrai que... peut-être que c'est l'âge avançant qui fait qu'on est un petit peu plus irascible mais je m'agace beaucoup aujourd'hui du haut de mes 46 ans avec le poids des paroles et le poids des principes et le poids des postures chez les chercheurs et les enseignants et enseignantes. Je trouve qu'il nous faut maintenant des actes. Il nous faut des pratiques concrètes qui mettent en œuvre nos principes et nos discours. Le performatif des discours, je pense que c'est bon. Alors on a suffisamment écrit, on a suffisamment dit, maintenant, faisons. Et comment est-ce que moi, je m'engage concrètement? Eh bien, j'ai un projet qui est en général global qui consiste à partager les espaces auxquels j'ai accès puisqu'il faut des diplômes, puisqu'il faut montrer patte blanche, puisque parfois il faut avoir une certaine couleur ou un certain genre ou un certain parler pour accéder à des espaces de communication à diffusion large, des espaces de crédibilité, je m'engage à partager les espaces auxquels j'ai accès. Donc ça donne des formations qui sont coanimées avec des artistes, y compris des artistes qui n'ont pas le baccalauréat, le diplôme d'études secondaires mais qui, par leur parcours de vie ou comme disent les artistes du hip hop par l'école de la Street, arrivent à des enseignements absolument primordiaux sur comment mieux vivre ensemble. Et chez les artistes du hip hop, notamment ici en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, je trouve cette capacité à vivre avec l'autre au sens fort du terme, l'autre qui a d'autres affinités politiques, qui a d'autres sentiments d'appartenance identitaire, qui a d'autres modes de vie, une capacité une facilité à vivre avec l'autre et à créer des œuvres avec l'autre et à produire du sens avec l'autre. Donc je trouve qu'on a beaucoup à apprendre du côté des artistes. Il y a autre chose qui me fascine chez les artistes, c'est leur capacité à marquer le public, à nous faire mémoriser, à nous faire ressentir, à nous faire réfléchir. Mais pour moi, ce sont les mêmes objectifs qu'un enseignant et qu'une enseignante. Faire ressentir, mémoriser, réfléchir, faire se poser des questions. Donc je me dis bon, il y a peut-être des choses que je devrais apprendre à côté des artistes parce que les artistes y arrivent. Et nous, au bout de 2 h de discours, de monologue, au bout de voilà, au bout d'un semestre de fatigue discursive, ben voilà, on n'a pas forcément réussi. Donc je m'engage à partager les espaces de recherche, d'écriture, de conférence avec des artistes. Et ça c'est quelque chose que j'ai commencé que je trouve très risqué, c'est palpitant parce qu'on sait jamais comment c'est reçu et c'est à chaque fois extraordinaire dans tous les sens du mot. Donc ça, ce sont mes engagements et je m'engage aussi à partager les espaces auxquels j'ai accès avec les plus jeunes, avec les étudiants et étudiantes. Et ça me permet de terminer sur une proposition de lecture. C'est une de nos dernières publications avec Véronique Fillol. Nous avons co-dirigé un ouvrage collectif destiné à essayer de découvrir comment les jeunes chercheurs et chercheuses construisent leur posture scientifique afin qu'elles soient impliquantes et impactantes socialement. Et cet ouvrage, il est gratuit, il est accessible en ligne dans son intégralité. Donc c'est cette lecture que je recommanderais avec une très belle couverture en aquarelle que j'ai pu proposer moi-même.
Emmanuelle 42:51
Il s'appelle comment ton ouvrage?
Elatiana 42:52
L'ouvrage s'appelle Posture de recherche... Attendez, on connaît pas très bien nos propres travaux, n'est-ce pas? Construire une posture de recherche impactante et impliquante.
Emmanuelle 43:07
Merci beaucoup. Et comme il est gratuit, qu'on peut tous y accéder, imagine par exemple que moi, je décide de l'utiliser dans un de mes cours. Est-ce que tu souhaiterais que les gens comme ça t'envoient une certaine rétroaction ou te fasse part de la manière dont ils l'ont utilisé, digéré. Enfin voilà,
Elatiana 43:28
Ce serait une mine d'or, ce serait une expérience absolument précieuse et je m'engagerai à partager avec les personnes concernées s'il y a des textes en particulier qui ont fait réagir des étudiants et étudiantes. On construit un pont et on fait rencontrer les personnes qui autrement ne se seraient jamais croisées.
Emmanuelle 43:49
Ça serait super. Alors moi je m'y engage à mon tour. Enfin, si tu avais un message à faire passer aux jeunes chercheurs et aux enseignants, voilà je ne vais pas en dire plus parce que je voudrais que ça vienne vraiment de toi, qu'est-ce que ça serait?
Elatiana 44:09
De façon spontanée et vraiment je dirais sincère, avec le cœur, ça serait de se poser une question qui, à mon sens, est trop souvent évacuée. Ce n'est pas tant de se dire, enfin de se demander pourquoi je fais de la recherche ou quelle est ma thématique ou quel grand sujet je vais attaquer et quelles sont les causes que je vais prendre en charge. Pour moi, ce ne sont pas ces questions qui sont centrales. La question qui, à mon sens, est centrale et trop souvent évacuée, c'est pour qui est-ce que je veux faire de la recherche. Pour qui? Et derrière cette question sur le qui, c'est aussi en tant que qui est-ce que je veux faire de la recherche? Donc c'est centré sur la question du sujet, la question de l'être humain parce que faire de la recherche pour des causes, on le sait, on a trop d'exemples aujourd'hui dans le contexte global, si on fait de la recherche pour des causes, on risque de détruire l'être humain en raison de ces causes qui sont abstraites, qui sont inexistantes. Alors que si on recentre les motifs de recherche autour de personnes et bien les causes elles viennent à partir et avec les personnes, voilà.
Emmanuelle 45:49
Merci, merci, alors aujourd'hui nous avons parlé de beaucoup de choses, de vraiment de concepts importants. On a parlé de réparation, de légitimité, de mobilité, d'espace, d'agentivité, de réparation épistémique, d'art et de production de sens mais aussi de français standard, de contextes post-coloniaux et puis enfin d'école de la Street, j'ai retenu. Merci pour tout ça Elatiana, ça va vraiment... on va nous emmener dans une réflexion encore mieux nourrie, je pense. Et puis il me reste à te souhaiter une bonne journée.
Elatiana 46:43
Merci beaucoup, vraiment. Merci du temps accordé.
Joey 46:48
Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux par courriel à crefo.oise@utoronto.ca