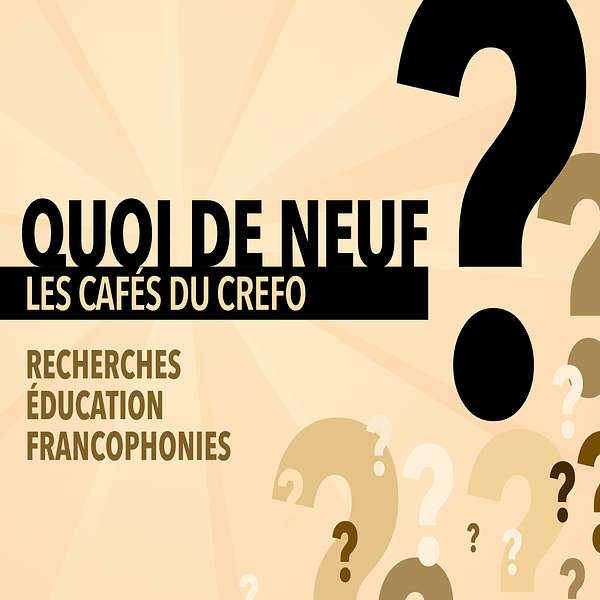
Quoi de neuf ?
Quoi de neuf ?
Langue, pouvoir et inclusion : Entretien avec Philippe Blanchet
Dans cet episode, Emmanuelle Le Pichon, directrice du CREFO, rencontre Philippe Blanchet, professeur d'université à l’Université Rennes-II.
Philippe Blanchet est professeur de sociolinguistique et de didactique des langues à l’Université Rennes 2 (France). Spécialiste reconnu des discriminations linguistiques, il a largement contribué à faire connaître et conceptualiser le phénomène de glottophobie, terme qu’il a introduit pour désigner les discriminations fondées sur la langue, l’accent ou la manière de parler. Ses recherches portent sur les liens entre langue, pouvoir, exclusion et justice sociale, avec un engagement fort pour la reconnaissance des langues minorées, la diversité linguistique et une éducation inclusive.
Auteur de nombreux ouvrages, dont Discriminations : combattre la glottophobie (2016), Philippe Blanchet milite pour une approche démocratique des langues, fondée sur le respect des locuteurs et la remise en question des normes imposées. Son travail interroge en profondeur les rapports entre langage et société, en mettant en lumière les mécanismes souvent invisibles de domination linguistique.
Autres articles :
Milin, R. et Blanchet Ph., 2025, Langues régionales : Idées fausses et vraies questions, Paris, Héliopoles.
Bergeron, C., Blanchet Lunati, Ph., Lebon-Eyquem, M., 2025, Insécurité linguistique et glottophobie en situations francophones périphériques. Une enquête comparative auprès d’étudiantes en Ontario, en Bretagne, en Provence et à La Réunion, Rome, Aracne.
Joey 00:00
Dans cet épisode, Emmanuelle Le Pichon, directrice du CREFO, rencontre Philippe Blanchet, professeur d'université à l'Université Rennes II.
Philippe 00:06
Les enfants à qui on enseigne les apprentissages de base dans leur langue sont favorisés, sont privilégiés et auront probablement une réussite scolaire et donc sociale et donc économique etc. bien meilleure que les enfants à qui on enseigne dans une langue qui n'est pas la leur et qu'on freine.
Joey 00:30
Bienvenue à Quoi de neuf?
Emmanuelle 00:32
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Quoi neuf? Les cafés du CREFO, le rendez-vous où nous explorons ensemble les liens entre langue, culture, éducation et diversité. Donc aujourd'hui, nous avons la grande chance, l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, Philippe Blanchet. Alors Philippe, tu es sociolinguiste, tu es professeur d'université, tu es l'un des grands spécialistes de la diversité linguistique et des discriminations liées à la langue. Tu corrigeras ma présentation si tu penses que c'est nécessaire. Je crois que je n'oublierai jamais notre rencontre. Les auditeurs doivent se demander pourquoi nous nous tutoyons. En fait, elle est quand même assez insolite, mais peut-être assez typique pour des linguistes. Nous nous sommes rencontrés dans un train entre Tokyo et Kyoto au Japon de cette année, alors qu'on aurait pu se rencontrer en Bretagne puisque j'y suis née. Je suis née à Brest et que j'ai un nom bien breton. Mais voilà, une rencontre fortuite mais ô combien heureuse puisque cela nous permet aujourd'hui de t'écouter. Alors ton travail est très lu, il est reconnu internationalement, notamment grâce à un concept que tu as lancé, qui est le concept de glottophobie, un concept qui désigne les discriminations fondées sur la manière de parler et dont tu vas, je l'espère, nous parler dans l'heure qui va suivre. Alors ensemble on va parler de langue, on va parler de relation de pouvoir entre les langues, d'enseignement bien sûr puisque c'est notre cheval de bataille, nous sommes en éducation et comment nous pouvons rendre l'école plus inclusive. Alors bonjour Philippe, merci d'être là aujourd'hui.
Philippe 02:38
Eh bien bonjour. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
Emmanuelle 02:43
Alors pour commencer, j'aimerais te poser une question toute simple qui est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux langues et plus particulièrement à la manière dont elles sont perçues et enseignées dans nos sociétés aujourd'hui?
Philippe 02:55
Alors bon, l'histoire, c'est toujours quelque chose qu'on raconte après. Donc peut-être qu'on voit des éléments qui sur le moment n'étaient pas très conscients, mais on se dit que finalement ils ont dû jouer un rôle. Donc d'abord, je me suis toujours intéressé aux langues aussi loin que j'ai des souvenirs. Enfant, j'ai toujours été captivé par le fait que les gens parlent des langues différentes. Il se trouve que j'ai eu la chance, je pense que c'est une chance, de naître et de grandir dans une famille plurilingue. Je suis né à Marseille, grande ville capitale de la Provence, dans une famille un peu d'origine italienne du côté de ma mère. Mais les Italiens, pour nous, ne sont pas des étrangers. C'est Juste des voisins, des cousins. On est beaucoup plus proche d'eux que des Parisiens ou des Alsaciens. D'une famille en gros originaire de la région Marseille, Aix, Toulon, donc le cœur de la Provence où la langue provençale avait résisté jusqu'à la génération de mes grands-parents, qui a été la première génération qui a appris le français à l'école plutôt sous la contrainte d'ailleurs. Et donc j'ai grandi dans une famille où j'entendais parler des variétés d'italien, où j'entendais parler provençal, où j'entendais parler le français tel que le parle les provençaux qui l'avaient appris comme langue seconde ou comme langue troisième, c'est-à-dire un français qui aujourd'hui est devenu très connu dans le monde, c'est mes grands-parents, c'est la génération des acteurs de Marcel Pagnol, des films de Pagnol donc avec plein de mots provençaux, avec ce fameux accent méridional provençal ou marseillais. Voilà, donc en fin de compte dans ma famille on parlait trois langues mais trois langues qui finalement étaient pas des langues légitimes, une langue régionale, un français local et une langue de l'immigration. En plus, à côté de moi, j'ai eu de tout petit, ma tante qui a épousé le frère de ma mère qui était une réfugiée qui avait fui le franquisme en Espagne et qui parlait donc espagnol et qui a appris le français de Marseille comme elle a pu, donc elle parlait un français de Marseille espagnol, donc un français provençal espagnol. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça. Du côté de mon père, une partie de ma famille et notamment ma grand-mère, sa mère, avait vécu assez longtemps en Algérie tout en étant provençale elle-même et donc elle avait appris aussi des façons de parler le français qu'on avait en Algérie à l'époque coloniale donc avec plein d'emprunts à l'arabe. Par exemple elle avait plein de mots un peu étranges pour les gens qui ne connaissent pas ce français-là. Et donc voilà tu vois j'ai grandi avec autour de moi plein de gens qui parlaient plein de langues un peu bizarres par rapport au modèle supposé mais complètement fictif de ce qu'on parle en France.
Emmanuelle 05:44
Bah dis donc, on commence sec, on commence avec réfugiés, légitimité, colonialisme, plurilinguisme, tu nous introduis à plein plein de choses, plein de concepts et j'allais te poser la question de savoir quelle était la place de la diversité dans ta vie. Alors on comprend, à l'origine, qu'il y a eu des éléments déclencheurs. Mais est-ce que tu as... enfin comment aujourd'hui est-ce que tu la vis cette diversité?
Philippe 06:10
Ben écoute d'abord dans une continuité parce qu'il se trouve que... tu vois la première chanson que je me souviens avoir apprise quand j'étais petit, c'est mon grand-père, le père de ma mère qui me l'a apprise, c'est une chanson en provençal et je la sais toujours par cœur. Ça m'a marqué. Et puis à partir de l'âge de, je sais plus peut-être 10-12 ans, mes grands-parents se sont rendu compte que c'était plus la peine qu'ils se parlent en provençal pour que je ne comprenne pas puisque j'avais tout compris, que je l'avais appris en les écoutant. Mon grand-père est mort assez rapidement, il était assez âgé. Il est né à la fin du 19ᵉ siècle et malade et c'était des petites gens de milieux ouvriers, leur corps était usé par le travail et ma grand-mère, du coup, s'est mise à me parler provençal massivement, presque exclusivement, et donc elle m'a transmis cette langue qui est devenue ma langue première, dans laquelle je suis très à l'aise, que j'ai moi-même transmise à mes enfants. Et tu vois, pas plus tard qu'hier ma fille, ma troisième fille était à la maison et avec ma fille on communique en provençal. Par exemple, on s'écrit... alors elle est plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral parce qu'elle a grandi en Bretagne, alors le provençal, elle n'a pas beaucoup entendu parler autrement que par papa ou par quelques amis, voilà. Mais elle m'écrit exclusivement ses textos par exemple, les jeunes communiquent beaucoup comme ça ou sur WhatsApp, en provençal. Et donc voilà cette diversité, je l'ai continuée toute ma vie. En plus après, j'ai voulu étudier davantage l'italien. J'en ai fait ma première langue au lycée au baccalauréat. J'ai fait des études d'anglais. J'ai une licence, une maîtrise d'anglais. J'ai été prof d'anglais. Je suis parti enseigner l'anglais au Nigeria où on parlait une autre variété d'anglais. Je suis parti enseigner le français au Nigeria où on parlait une autre variété d'anglais et où j'ai appris à parler la langue locale parce qu'une des choses qui a toujours été un principe pour moi, c'est quand on va vivre avec des gens, qu'on travaille avec eux, il faut apprendre leur langue pour mieux les comprendre, pour mieux s'intéresser aux gens. Puis aussi parce qu'un ami marocain me le disait encore récemment, puisque ayant beaucoup travaillé au Maghreb, en Algérie, au Maroc, j'ai aussi appris de l'arabe maghrébin. Il me disait l'avantage, c'est que même si tu parles pas beaucoup, le fait que tu nous dises un certain nombre de petites choses dans notre langue, ça change complètement la relation. Du coup tu es des nôtres, tu viens vers nous, voilà. Et donc toute ma vie je me suis intéressé à ça. Puis tu vois les étudiants qui viennent dans notre master de plein de pays du monde qui arrivent avec leur langue, leur variété de français. Les doctorants que j'ai dirigés dans plein de pays du monde aussi, pas seulement en France, y compris que j'ai co-dirigé au Canada par exemple, à l'université de Moncton en Acadie, à Montréal. Enfin bon, voilà. Du coup j'ai baigné là-dedans tout le temps. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit à propos d'Astérix et j'ai continué toute ma vie encore aujourd'hui à vivre intéressé, passionné par ça. Au fond, c'est le fil conducteur de ma vie.
Emmanuelle 09:15
Alors j'adore un certain nombre de choses que tu viens dire, mais en particulier que tu remettes au cœur de cette éducation plurilingue les parents et les grands-parents. Moi je viens de devenir grand-mère alors ça me parle particulièrement mais effectivement je me souviens que dans le train tu m'as montré des textos de ta fille en provençal et tu en étais super fier. Donc quand même une fille élevée en Bretagne et qui envoie des textos alors ça met aussi au cœur de notre conversation aujourd'hui les nouveaux moyens de communication que sont le téléphone, les textos, les WhatsApp etc. et qui peuvent être en fait un moyen de parler de cette diversité. Juste par curiosité au Nigeria, c'est quelle langue que tu as apprise? L'haoussa?
Philippe 09:21
Oui, l'haoussa. Je vivais en pays haoussa au nord du Nigeria. C'était la langue principale de communication des gens avec qui je vivais.
Emmanuelle 09:38
Et j'adore quand tu dis « si tu apprends ma langue, tu viens vers nous ». Ça, je trouve ça très très beau. Alors tu défends, on l'a bien compris, une approche plurilingue de l'enseignement. Concrètement, tu nous montres bien que chaque élève arrive avec un bagage linguistique et culturel propre. Alors ma question, d'emblée on va aller directement vers l'école, comment est-ce que tu penses qu'elle peut s'adapter à cette réalité sans tomber dans une logique de standardisation, encore une fois?
Philippe 10:41
Alors, il y a des tas de façons. Je pense qu'il y a un principe absolument fondamental qui est défendu par l'UNESCO depuis très Longtemps, qui est que les apprentissages de base doivent être réalisés dans la langue ou une des langues, parce que souvent ils en ont plusieurs, qui est familière aux enfants et notamment leur langue familiale, il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs parce que souvent la langue de papa, la langue de maman ou la langue du grand-père, la grand-mère ne sont pas les mêmes. Parce que du coup, ils n'ont pas à faire l'effort d'apprendre en même temps à lire et à écrire et la langue qu'on leur apprend à lire et à écrire. Ils n'ont pas l'effort à faire d'apprendre à compter en même temps qu'on leur apprend la langue dans laquelle on leur apprend à compter, ce qui évidemment provoque des difficultés très grandes. Je suis d'ailleurs très admiratif du fait que les enfants y arrivent quand même, mais ils y arrivent moins bien et surtout ça crée, autre sujet qui nous relie aujourd'hui, ça crée des discriminations puisque ça veut dire que les enfants à qui on enseigne les apprentissages de base dans leur langue sont favorisés, sont privilégiés et auront probablement une réussite scolaire et donc sociale et donc économique etc. bien meilleure que les enfants à qui on enseigne dans une langue qui n'est pas la leur et qu'on freine, à qui on fait obstacle dans leur réussite scolaire et donc sociale et donc économique etc. Donc ça je pense c'est vraiment un principe de base et quand je dis dans leur langue ça peut être aussi dans leur variété de langues. Je veux dire que par exemple en Ontario les petits francophones qui arrivent à l'école, il faut pas leur enseigner à lire, à écrire, à compter les premières choses à l'école que nous on appelle l'école primaire, élémentaire en France, en français standard de la bourgeoisie parisienne ou même en français standard de la bourgeoisie montréalaise. Il faut leur enseigner dans le français familier que parlent les petits francophones ontariens, qu'ils soient à Toronto ou aux alentours dans les autres communes. Ça c'est vraiment pour moi un principe de base, y compris parce que et je termine là-dessus, en reconnaissant la dignité de leur façon de parler, de leur variété ou de leur langue, y compris dans leur langue venue d'ailleurs, on reconnaît leur dignité à eux et on reconnaît la dignité de leur milieu familial et social. Et donc on travaille une estime de soi positive qui permet de se lancer dans l'apprentissage, dans la relation aux autres, prendre la parole devant la classe ben oui, mais pour oser prendre la parole devant les autres, il faut avoir une estime de soi et le sentiment que ce qu'on parle est digne d'être parlé devant les autres. Et du coup, ça a aussi un impact sur la construction de la personne. C'est pas seulement les apprentissages techniques, ça touche à qui on est.
Emmanuelle 13:33
Oui alors ici, j'ai rencontré dans plusieurs classes des enfants dont les parents étaient de la Jamaïque et j'ai même eu l'occasion de parler avec les parents et ça crève le cœur parce que très souvent, la manière dont ils nomment leur propre langue, c'est de l'anglais cassé, broken English et ils disent non mais on peut pas comme ça, on peut pas le parler. C'est un peu leur langue, leur langue secrète mais pas une langue dans laquelle ils vont oser parler devant les autres. Et là tu remets en avant, tu as parlé de l'estime de soi, de dignité dans la façon de parler que je trouve absolument merveilleuse. Alors on arrive au concept, ou au terme, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, de glottophobie qui a beaucoup fait parler de lui. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots ce que c'est et pourquoi c'est un enjeu, même si on l'a déjà compris un petit peu, aussi important dans le monde éducatif d'aujourd'hui.
Philippe 14:34
Alors tout simplement déjà alternative entre terme et concept eh bien il y a une solution facile c'est un terme conceptuel, c'est-à-dire c'est un terme que j'ai forgé mais j'ai pas eu beaucoup de mal à l'inventer, je vais vous expliquer comment, j'ai pas beaucoup de mérite, mais que j'ai forgé pour rendre visible un concept. C'est-à-dire pour rendre visible une notion, une idée qui permet de désigner quelque chose qui se produit dans le monde social et qu'on ne voit pas ou qu'on voit mal si on n'a pas une étiquette pour mettre dessus. D'ailleurs, l'un des retours fréquents que j'ai eu de la part des gens qui m'ont contacté après que ça se soit beaucoup diffusé, notamment en France, c'est les gens me disent merci parce que c'est quelque chose qu'on vit mais qu'on sait pas nommer et comme on sait pas le nommer, on a du mal à l'identifier, on a du mal à le voir. Donc voilà ce que c'est un concept, je crois que c'est important de dire ça aussi parce que souvent le mot concept, il a un côté très abstrait, très intello ou au contraire, il a un côté très mercantile. Vous savez, maintenant les marchands vous vendent des concepts de quelque chose. En fin de compte, c'est un outil qui permet de voir quelque chose et de le nommer. Alors pourquoi glottophobie? D'abord d'où ça vient? Parce que pendant de nombreuses années, alors vous comprenez bien que j'ai moi-même vécu ça, y compris tu parlais de la langue cachée, ben chez nous, c'est pareil. Comme on nous a dit que notre langue n'était pas digne et qu'on n'en voulait pas en France, c'est une langue qui est devenue une langue cachée qu'on parle dans la famille ou entre amis mais qu'on parle pas sur la place publique. Je me rappelle un vieux pêcheur que j'avais interviewé dans mon petit village ou petite ville d'origine, me disait, qui avait le provençal comme langue première, je l'interviewais en provençal mais il avait 50 ans de plus que moi, j'étais jeune, je faisais ma thèse de doctorat. Il me disait on nous a appris qu'on avait le droit de parler provençal en mer sur le bateau parce qu'on est entre nous, mais dès qu'on touchait le quai et qu'on arrivait sur la terre, on était obligé de passer au français parce que c'était pas poli de parler provençal aux gens qu'on connaît pas. Donc tu vois voilà, j'ai cette histoire-là, j'ai fait des enquêtes, j'ai plein de témoignages et du coup l'idée c'était de se dire mais pourquoi est-ce que le monde linguistique est pluriel et on essaye d'empêcher les gens de vivre cette pluralité. Et donc pour essayer de comprendre pourquoi il y a une action idéologique, politique, militante qui essaye d'empêcher les gens de vivre leur pluralité linguistique spontanée, j'ai été voir si on ne pouvait pas expliquer ça par, au fond, une politique de discrimination puisqu'il y a aussi un lien entre la langue que je parle et mon origine, entre la langue que je parle et mon milieu social, évidemment, j'avais des pistes, j'ai pas inventé ça tout seul. D'abord, on y a travaillé collectivement, comme toujours quand on fait de la recherche dans notre labo à Rennes II et j'ai très Vite pu confirmer le fait que c'est bien une discrimination, parce que d'une part, il y a un droit fondamental à être soi-même, y compris sur le plan linguistique et à s'exprimer dans sa propre langue. Mais c'est un droit qui est souvent caché. Il est dans les textes mais on ne dit pas aux gens qu'il y est et puis que du coup ça créait bien des disparités, des différences de traitement, des inégalités qui étaient arbitraires, qui étaient injustes. Pourquoi toi tu as le droit de faire des études en parlant ta langue et toi tu n'as pas le droit. Pourquoi toi, tu as le droit d'avoir un emploi avec ton accent en français, mais toi tu n'as pas le droit d'avoir cet emploi avec ton accent en français, etc. Donc l'idée ça a été de dire OK, très bien, j'ai compris le phénomène. Au fond, c'est un phénomène de discrimination que certaines parties de la société utilisent pour garder, s'octroyer et conserver des privilèges, des privilèges de réussite éducative, de capital culturel donc de réussites sociales et économiques, d'accès au pouvoir aussi au poste de pouvoir et pour empêcher les autres d'y accéder. Mais cette discrimination, pour la rendre bien visible, il fallait la nommer justement et donc existait déjà, bien longtemps avant, la notion de discrimination linguistique. Simplement quand on a voulu vérifier si cette étiquette était fonctionnelle et donc on a fait une petite enquête qui a très vite montré que quand on demande aux gens c'est quoi pour vous une discrimination linguistique, les gens répondent presque toujours c'est quand on discrimine une langue. Sauf que c'est pas les langues qu'on discrimine, c'est les personnes qui les parlent. Les gens qui vivent les effets de la discrimination c'est pas les langues, les langues sont des abstractions, c'est les gens et du coup je me suis dit discrimination linguistique c'est pas une bonne façon de nommer ça. Il va falloir trouver un terme qui montre que c'est pas une question de langue, que c'est une question d'organisation de la société. Et donc comme il y avait un paradigme, comme les linguistes disent, c'est-à-dire une série de termes qui servaient déjà à désigner les discriminations, dont les plus anciens termes sont xénophobie, islamophobie, judéophobie, homophobie est un peu plus récent mais il s'est très largement répandu dans beaucoup de sociétés, francophones notamment, j'ai pris le même paradigme mais j'ai dit « phobie » c'est le rejet, devant c'est le prétexte du rejet « xéno » c'est tu es étranger, « homo », c'est ton orientation sexuelle. Donc il fallait un mot en grec qui désigne la langue. En grec pour désigner la langue « glotto » comme dans polyglotte, plusieurs langues, donc glottophobie. Et voilà pourquoi ce terme. Alors du coup je l'ai inventé à la fin des années 90. J'ai commencé à le mettre dans des publications scientifiques. Personne n'a réagi ni bien, ni mal. Ça avait l'air de fonctionner, mais ça touchait que des linguistes. Et puis parce que je trouve que notre rôle de chercheur c'est aussi, surtout en sciences humaines et sociales, d'apporter quelque chose pour améliorer la société et régler les problèmes que les gens rencontrent, j'ai commencé à en parler publiquement. On m'invitait à faire des conférences dans des universités d'été de partis politiques, dans des syndicats, dans... voilà. Et là les gens m'ont dit mais on voit très bien de quoi tu parles, on l'a tous vécu, donc il faut faire un bouquin grand public. Alors j'ai fait ce livre Discriminations : combattre la glottophobie et du coup, le terme c'est vraiment très largement répandu, en France en tout cas parce que c'est peut-être le pays du monde où il y a le plus de glottophobie, la glottophobie, elle fait même partie de l'organisation structurelle de la société française. Et puis bon voilà, le terme a fini par entrer dans les médias, il est entré dans les dictionnaires usuels, le Robert, le Larousse, etc. Il a commencé à être traduit, enfin adapté en espagnol, en italien, en anglais. Voilà et du coup puisqu'il marche bien et bien je le garde.
Emmanuelle 21:34
Alors, tu as parlé de cet enjeu sociétal de la glottophobie, mais à mon avis, il y a encore un contexte dans lequel il n'est pas encore, si ce n'est utilisé, du moins compris, c'est l'école. Ma question suivante c'est est-ce que tu penses que l'école est aujourd'hui plutôt un lieu de reproduction de la glottophobie ou de combat contre la glottophobie? Ou bien les deux? Et quoi faire? Est-ce que tu as des exemples? Je dirais plutôt des exemples positifs parce que nous, on est à la recherche, on est en éducation, on essaie. Voilà.
Philippe 22:13
Alors ça tombe bien parce que j'allais justement commencer par des exemples positifs parce que je garde un optimisme dans la possibilité d'améliorer le monde même s'il va pas bien et si nos combats ont du mal à aboutir. Mais bon, il faut croire que les graines qu'on sème finiront par fleurir. Alors, d'abord on peut pas parler de l'école en général. Il y a des systèmes éducatifs qui sont en général fortement dépendants des sociétés dans lesquelles ils sont construits, mis en œuvre, etc. dans lesquels ils se transforment, soit de l'État au sens de l'organisation institutionnelle de la société, soit d'autres institutions parce qu'il y a des pays, des sociétés dans lesquelles il y a d'autres institutions qui sont en charge de l'école au sens de l'éducation formelle des enfants. Et j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des responsables de systèmes éducatifs qui m'ont montré que dans leur pays, dans leur société, on essayait de prendre en compte l'ensemble des langues ou le plus grand nombre possible de langues que parlent les familles, les populations, les enfants pour leur faire une place à l'école, y compris en les organisant. Moi, l'une de mes rencontres les plus frappantes, c'était l'ambassadeur de Bolivie à l'UNESCO qui est très intéressant comme ambassadeur parce qu'il était un jean, en T-shirt, il avait une queue de cheval, il correspondait pas du tout à l'image du diplomate occidental et c'était très bien et c'était très cohérent avec ce dont il m'a parlé. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué comment dans la Constitution, on garantit l'ensemble des droits linguistiques et des populations, y compris avec le droit de se reconnaître comme étant d'aucun groupe, mais comme étant un interculturel et comment, ce qui est extraordinaire voilà, et comment on avait organisé dans l'école le fait que les enfants sont scolarisés dans la langue principale de la zone dans laquelle ils vivent, avec l'obligation d'apprendre deux autres langues qui doivent être l'espagnol mais qui n'est pas forcément leur langue première mais ceux qui ont l'espagnol comme langue première ont l'obligation d'apprendre des langues autochtones parce qu'il faut qu'ils apprennent trois des langues qu'on utilise, dont une langue autochtone véhiculaire puisqu'on est dans une partie d'Amérique du Sud où il y a encore heureusement des langues autochtones qui ont des fonctions véhiculaires, comme le quechua par exemple. Donc il y a des exemples où ça fonctionne. Il y a les tentatives en Afrique de l'Ouest que je suis depuis très longtemps, depuis les années, ça a commencé dans les années 80, de mettre en place une école où les enfants ont leurs premiers apprentissages dans les langues principales dans lesquelles ils vivent, où le français qui était, qui n'est plus toujours aujourd'hui d'ailleurs, la seule langue officielle est introduite progressivement. Donc voilà, il y a des exemples. Et puis je connais ponctuellement des enseignants, des enseignantes, y compris en France où, c'est pas la perspective dominante, qui dans leur classe, accueille les langues de leurs élèves. Je pense par exemple aux enseignants qui accueillent les enfants qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas francophones et qui mettent en place toutes sortes d'approches pédagogiques plurilingues pour aider les enfants à apprendre le français, qui apprennent les langues de leurs élèves, c'est quand même extraordinaire, pour pouvoir aider leurs élèves à apprendre le français. Donc il y a partout des gens qui ont plein d'excellentes idées qui marchent. C'est ça qui est super. C'est de se dire, contrairement à ce que pensent les monolingues qui vivent dans des sociétés et dans des écoles monolingues, le plurilinguisme, la pluralité linguistique, y compris les variétés locales, c'est pas compliqué. On sait faire, on a tout ce qu'il faut pour que ça marche simplement, il faut le faire. Or, et je termine de répondre à ta question, dans d'autres sociétés, l'école est principalement un lieu d'inculcation des normes sociales dominantes, y compris des normes sociolinguistiques dominantes où on amène les enfants à se conformer à ces normes et où on impose à l'ensemble des enfants à l'école les langues en l'occurrence et les façons de les parler, je pense aux variétés du français, des classes dominantes qui ont le pouvoir de le faire, c'est-à-dire qui ont le pouvoir de l'imposer. Et donc effectivement dans ce cas-là, l'école c'est un lieu de reproduction des normes dominantes et donc du coup de sélection des enfants qui viennent des milieux linguistiques où on parle déjà les normes dominantes, qui donc auront accès aux lieux de pouvoir et le revers de ça, c'est que l'école est un lieu de discrimination et de rejet des enfants qui parlent autrement, soit le français pour prendre l'exemple des sociétés francophones comme la France, soit qui parlent d'autres langues, qu'elles soient régionales comme les langues qu'on parle en Guyane, on parlait tout à l'heure de la Guyane qui est un département français d'Amérique du Sud, où on sait que l'immense majorité des enfants parlent pas français, arrivent à l'école en parlant d'autres langues, mais l'école est uniquement en français. Et du coup, on voit bien comment ça les exclut de la réussite scolaire, ça les exclut même en tant que citoyen, ils n'ont pas le droit d'être des citoyens comme les autres puisqu'on conditionne l'accès à la citoyenneté, à la reconnaissance de la citoyenneté au fait de s'exprimer en français.
Emmanuelle 27:48
Tu me rappelles un de mes étudiants ici à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, qui venait de l'île Maurice et qui était enseignant de français dans les écoles anglophones et qui me disait Emmanuelle, explique-moi comment ça se fait que ça marche à l'île Maurice et que ça marche pas au Canada. C'était quand même assez, voilà, brutal comme question, mais très intéressant parce qu'en fait, il y a d'emblée ici une grande bienveillance vis-à-vis des langues qui arrivent. Donc la question que je voulais te poser ensuite, c'était toi qui as aussi non seulement travaillé sur le français, mais aussi beaucoup travaillé sur des langues régionales et notamment récemment sur le breton - j'ai eu quelques conversations avec toi sur le breton - est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui du combat des, mettons, des Bretons, mais peut-être que tu as d'autres exemples, pour valoriser leur langue? Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a un cadre légal suffisant pour protéger les locuteurs de ces langues dans le système existant?
Philippe 28:54
Tu veux dire en français?
Emmanuelle 28:57
Oui, oui et puis on peut élargir à plus large que ça.
Philippe 29:02
Oui, mais parce que du coup, ton exemple du Mauricien qui vient au Canada met le doigt sur un point clé, c'est que les contextes sociétaux, les lois, y compris de politiques linguistiques, l'organisation sociolinguistique de la société est différente d'un endroit à l'autre. Et du coup, ça amène les gens à avoir un rapport à la pluralité linguistique, au plurilinguisme et aux différentes langues qui peut être extrêmement variable même quand c'est les mêmes langues d'une société à l'autre. Par exemple, deux sociétés francophones peuvent avoir des rapports au français, aux variétés du français, aux autres langues extrêmement différents. Le Canada, par exemple, est beaucoup plus ouvert. Au Canada, la société est beaucoup plus ouverte au plurilinguisme et à un certain nombre de variations des langues anglaises et françaises puisque c'est les deux langues officielles fédérales, en tout cas, qu'en France par exemple. Ce qui veut pas dire que le Canada est un paradis linguistique. Il y a encore des choses à améliorer. Mais quand même, ça va mieux. Alors si on prend l'exemple de la France et pour répondre à ta question, d'abord il faut distinguer en gros deux choses. C'est très schématique ce que je dis mais les langues qu'on appelle régionales en France qui est un terme inventé par l'éducation nationale quand même, c'est pas le terme qu'emploient les gens spontanément pour les déclasser comme n'étant pas des langues nationales, et n'étant pas la seule langue nationale. Ces langues, il y a deux situations globalement. Il y a ce qu'on appelle les outre-mer puisque la France étant un ancien empire colonial qui a gardé des confettis d'empire colonial un peu partout dans les océans, principalement ou la Guyane, on en parlait tout à l'heure, dans les outre-mer parce que pendant longtemps l'état français a considéré que c'était des colonies, d'ailleurs ça a eu le statut officiel de colonie jusqu'en 1945. On a laissé les gens parler la langue parce que, comme l'état français l'a fait d'ailleurs par exemple en Afrique subsaharienne, on considérait que les gens n'étaient pas dignes d'apprendre le français, ce n'était pas la peine de le leur apprendre, il suffisait de former une élite qui servait d'intermédiaire entre le pouvoir de l'état français et les populations locales. Et donc aujourd'hui encore dans la majorité des outre-mer français, je prends un exemple que je connais bien qui est l'île de la Réunion pour y avoir beaucoup travaillé, le créole réunionnais, c'est la langue de la vie quotidienne et on sait qu'à peu près 80 % des enfants arrivent à l'école en ayant grandi à peu près exclusivement, en tout cas de façon dominante, en créole réunionnais. Et puis il y a les langues de la France que j'aime pas appeler métropolitaine parce que dans métropole, il y a aussi l'idée d'un centre dominant sur le reste du monde. Alors en général, je l'appelle la France européenne continentale. C'est un peu plus compliqué, mais je crois qu'on voit bien de quelle partie je parle. Là les langues régionales ont été beaucoup plus férocement combattues par l'état central tout au long du XIXe et de la première moitié du XXᵉ siècle et leur taux de pratique est devenu beaucoup plus bas. Alors c'est très variable selon une région ou une autre. Mais du coup, c'est souvent des langues que parlent les grands-parents, que parlent plus les enfants, qui sont très peu présentes dans la vie publique dont elles sont exclues, même s'il y a des militants qui arrivent à les faire revenir un peu et du coup, c'est de ça qu'on parle. Ce qu'on peut apprendre, c'est toute une série de choses. Par exemple qu'il y a des secteurs que les gens ont négligé et qu'ils ont eu tort de négliger. Il y a le secteur de la vie publique. En gros, les militants dont je ne suis pas, moi je suis un observateur et je suis un accompagnateur, y compris en donnant les outils, les éléments et en dénonçant ce qui se passe. Mais les militants ont focalisé sur l'enseignement de la langue dite régionale avec l'idée que, comme la transmission était en train de disparaître rapidement, en gros entre, selon les régions, entre 1930 et 1950, il fallait remplacer la transmission familiale par une transmission scolaire qui a commencé à se développer petit à petit, notamment dans des réseaux associatifs d'écoles militantes à partir des années 1970. Et je pense que ce faisant, d'abord ils ont mis la charrue avant les bœufs, comme on dit en français - en parlant de ça, on dit mettre à la charrette devant l'âne, parce que donner une place à une langue dans le système éducatif, ça ne peut avoir d'effet qu'à condition que cette langue elle ait préalablement ou au minimum en même temps retrouvée une place dans la société en général, dans la vie publique en général, dans la vie économique en général, parce que quoi qu'on en pense, la vie sociale est aussi faite de relations économiques, commerciales, etc. et c'est un secteur qui est devenu dominant dans le monde presque partout quoi qu'on en pense aussi, on peut le regretter. Personnellement, je regrette, je le cache pas. Mais c'est là, et de ne pas investir ça, c'était une erreur parce que du coup, la langue est cantonnée à un usage scolaire un peu artificiel. Et quand les élèves sortent, même s'ils ont eu des classes bilingues, il y en a de plus en plus ou des écoles carrément immersives en langue régionale pour compenser l'immersion permanente en français, le problème c'est que quand ils sortent, ils sont dans une société qui est massivement francophone. Voilà.
Emmanuelle 34:22
Donc si je te comprends bien, tu es en train de nous dire qu'il faut redonner une valeur marchande aux langues régionales, aux langues enfin minorisées.
Philippe 34:30
Alors marchande, c'est peut-être pas le mot que j'aurais utilisé, mais il faut que ces langues existent aussi dans la vie publique des institutions, donc qu'on se batte aussi pour qu'elles puissent avoir un statut de langue co-officielle, par exemple au niveau local, que ces langues puissent être utilisées dans les espaces publics, dans les médias, mais aussi effectivement - d'ailleurs tout est lié - dans la vie économique, ce qu'on peut montrer parce que dans les faits, c'est vrai qu'on peut avoir des emplois grâce au fait qu'on est habile dans une langue dite régionale parce qu'il y a des emplois pour lesquels c'est un plus. Et donc voilà, montrer qu'il y a une valeur qui n'est pas que marchande mais voilà qui est cette valeur-là, que ça apporte quelque chose aussi sur le plan économique, je dirais ça. Donc il faut ne pas investir que le secteur de l'éducation, mais l'ensemble des secteurs, à tous les niveaux depuis la loi, y compris combattre la constitution si la constitution n'est pas conforme au respect de la pluralité et des droits linguistiques et aussi de nos vies quotidiennes en défendant le droit de parler ces langues et en les parlant nous-mêmes dans la vie quotidienne. Alors évidemment, parler provençal en Bretagne, c'est un peu plus compliqué parce que la relation linguistique c'est toujours une relation avec les autres. Donc j'ai le droit de parler ma langue, mais les autres ont le droit de parler la leur, donc il faut qu'on négocie un équilibre bien sûr. Mais que, par exemple, la moindre des choses, c'est que je puisse parler provençal en Provence et qu'on puisse parler breton dans la partie de la Bretagne dont ça a été longtemps la langue usuelle. Et ça, il faut le faire aussi nous-mêmes, dans nos vies quotidiennes. C'est pas seulement du discours et de la règle générale. C'est de la pratique.
Emmanuelle 36:20
Oui, alors moi, j'ai assisté l'année dernière à quelque chose de très émouvant. C'était ici au parlement de l'Ontario et le parlementaire, qui est lui-même d'origine autochtone, a eu officiellement la permission de faire son discours en langue autochtone. Et si c'était déjà le cas à Ottawa, ça ne l'était pas encore à Toronto, c'était pas encore permis et c'était très très émouvant. Il y avait les communautés autochtones qui étaient représentées dans les rangs du parlement et ça fait plaisir de t'entendre dire que ça va avoir un effet sur la valeur économique puisque je n'ai plus le droit de dire marchand.
Philippe 36:56
Tu as le droit de dire absolument ce que tu veux
Emmanuelle 36:59
Non, non mais tu as bien sûr...
Philippe 37:01
Non mais ce que je veux dire par là, et ton exemple est très beau, c'est qu’il faut que ça... il y a un terme qui est utilisé de plus en plus par un certain nombre de mes collègues, y compris de mes collègues spécialistes du breton ici, ils parlent de revernacularisation, c'est-à-dire de faire en sorte que cette langue qui était vernaculaire, c'est-à-dire qui était la langue de la vie quotidienne redevienne une langue qui a une place dans la vie quotidienne et ça passe aussi par ça. Par exemple, de plus en plus on voit qu'il y a un investissement des espaces publicitaires où on entend, en France maintenant, des publicités dans des variétés du français qui ne sont pas que du français standard ou des publicités où il y a des messages en langues dites régionales. Et je pense que c'est une bonne chose, à une condition, y compris pour l'exemple du monsieur dont tu viens de parler, c'est que ça ait un véritable effet d'entraînement et que ça ne soit pas simplement de l'ordre du symbolique. Le symbolique est important. Les humains vivent dans du symbolique et on a besoin de ces symboles qui sont des symboles qui nous autorisent, qui redonnent de la dignité, comme je disais tout à l'heure. Mais ça suffit pas. Il faut du symbole et il faut aussi des mesures concrètes, pratiques qui ont des effets d'entraînement, d'une pratique massive.
Emmanuelle 38:13
Oui, parce que lui-même a dit dans son discours, il a dit mais vous savez que c'est difficile pour moi de donner ce discours en langue autochtone parce que c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire dans cette langue. Donc il faut que je m'y remette.
Emmanuelle 38:28
Mais lui-même...c'était très beau parce qu'il avait fait venir sa mère malade qui était là dans les rangs, qu'il a remerciée. Donc il a remercié, en particulier les ancêtres, de nous avoir transmis des langues et des pratiques. Alors j'aime bien poser une langue... une question, excuse-moi, à mes interlocuteurs qui est la suivante « Si tu pouvais imaginer l'école idéale dans 10 ans. Si on te donnait tous les moyens du monde, en matière de langue en particulier, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait et est-ce que tu pourrais, par exemple, nous décrire une journée type dans cette école ».
Emmanuelle 38:28
Voilà, c'est ça, c'est ça. Absolument.
Philippe 39:02
Alors, celle-là, je ne m'y attendais pas. J'ai des éléments de réponse mais je suis pas sûr de pouvoir dessiner complètement l'école idéale en question. Alors d'abord, je dirais que la question des langues elle doit s'inscrire dans une question plus générale. L'une des erreurs, y compris que font les gens qui défendent des langues, c'est de défendre des langues. C'est-à-dire de ne pas défendre un projet de société dans lequel les gens qui parlent des langues diverses ont leur place mais de défendre des langues pour des langues. Et je pense qu'ils se trompent parce qu'il faut changer le projet de société et en l'occurrence, il faudrait aussi que cette école idéale elle puisse fonctionner dans une société où elle a sa place et on lui laisse le droit d'exister. Mais mettons que l'école est une micro-société. Il faut organiser cette micro société sur des principes fondamentaux qui mettent en évidence, qui donnent de la dignité même qui font une ressource de la pluralité, pas seulement de la pluralité linguistique, de la pluralité sociale, de la pluralité culturelle, de la pluralité des expériences de vie et donc en gros il faudrait un modèle pédagogique, alors pas modèle au sens pour modéliser, mais une matrice peut-être que c'est le meilleur terme, une matrice pédagogique qui s'appuie sur l'expérience, sur la vie des gens, la vie des élèves, la vie de leur famille, pour faire entrer leur vie dans l'école. Que l'école soit en continuité avec leur vie et que du coup, elle soit en continuité linguistique avec la vie de ces enfants, de leur famille mais aussi de la société parce que toutes les sociétés sont linguistiquement plurielles et plurilingues. Alors il y a des exemples connus de matrice pédagogique. J'ai un petit faible pour un grand pédagogue provençal, pas seulement parce qu'il était provençal, mais parce que c'est un grand pédagogue dans ce sens-là, c'est Célestin Freinet. Et donc je pense que ça voudrait dire, par exemple, avoir un mode d'organisation pédagogique qui soit par exemple celui de l'éducation façon Célestin Freinet. Mais il y a d'autres exemples. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour le projet d'éducation émancipatoire de Paulo Freire au Brésil qui pour moi est aussi un grand exemple et qui d'ailleurs ça se rejoint beaucoup ces modèles-là. Donc ça voudrait dire ça déjà, faire le choix d'une conception même que ce que c'est que vivre ensemble pour apprendre dans une école. Et puis ça voudrait dire du coup faire de la place aux langues, alors d'ailleurs Freinet lui-même, qui parlait provençal, faisait de la place aux langues. Et donc ça veut dire mettre en place des activités que les élèves peuvent réaliser au moins dans un premier temps dans la langue de leur choix. Puis ensuite, on va converger pour échanger, y compris en disant « oui, mais toi, tu l'as fait dans une langue que je comprends pas, moi je vais te dire ce que j'ai fait dans la mienne et on va essayer de voir si on a fait la même chose ou plus ou moins la même chose dans des langues différentes ». Voilà l'école Freinet c'est l'école qui commence toujours le matin par donner la parole aux enfants en leur disant de raconter une expérience de vie. Eh bien, ça peut être une expérience linguistique et ça peut être aussi un récit plurilingue parce qu'il faut toujours se rappeler que parler sa langue c'est bien, c'est un droit, on en a besoin, mais il faut aussi parler la langue des autres. Et donc ça va apprendre le respect linguistique mutuel. Au fond, ça veut dire une école qui soit interlinguistique et interculturelle. Je dirais que ça serait plutôt ça, voilà. Et une école où du moment que quelqu'un fait l'effort, a la générosité d'essayer de parler une autre langue, ça soit toujours évalué positivement. Qu'on interdisent les notes et notamment les notes négatives, qu'on dise jamais « tu parles mal », qu'on dise « tu essayes de parler avec nous une langue qu'on comprend. Merci, merci pour ce beau geste ». Alors évidemment, ça change pas mal le rapport aux langues qu'on a d'habitude à l'école. Mais je sais que ça marche parce que, au lieu de produire de l'insécurité linguistique, des élèves qui vont devenir mutiques, qui vont arrêter de parler parce qu'on leur dit tout le temps qu'ils font des fautes, qu'ils parlent mal, j'ai plein de témoignages de gens qui me racontent qu'à l'école ils ont arrêté de parler français parce qu'on leur disait qu'ils parlaient mal français ou d'apprendre l'anglais, ou l'espagnol parce qu'on leur disait qu'ils le parlaient mal et quand ils le parlaient, parce qu'on le parlait dans leur famille, parce que c'était des gens d'origine immigrée, on leur disait qu'ils ne parlaient pas le bon espagnol ou le bon arabe ou le bon italien ou que sais-je encore. J'en ai plein de témoignages. C'est-à-dire qu'on les a empêchés, non seulement d'être élèves, mais de s'appuyer sur leurs pré-acquis en jugeant négativement les capacités qu'ils et elles avaient déjà. Et donc pour moi, il y a un principe fondamental, c'est l'évaluation au moins sur le plan linguistique, mais je pense qu'on doit pouvoir élargir la chose, elle doit toujours être encourageante, constructive, positive.
Emmanuelle 43:59
Formidable! Eh bien dis-donc, si un jour un auditeur qui nous écoute a besoin de quelqu'un pour l'aider à rêver à l'avenir de son école, je vais lui conseiller de te contacter. Alors pendant que tu parlais, je pensais à Joey, qui est avec nous sur ce plateau aujourd'hui, qui lui a été victime de discrimination linguistique en français, il le raconte assez facilement, et qui a du coup, à l'époque, décidé de continuer ses études en anglais parce qu'on lui avait dit qu'il n'avait pas le bon accent, voilà. Moi quand j'ai appris cette histoire, j'en étais bouleversée parce que... souvent, ce sont des choses qu'on comprend pas quand on vient de loin, n'est-ce pas? Mais merci beaucoup. J'avais aussi l'impression que tu décrivais mon École amie des langues, alors ça me faisait très très très plaisir. Alors je voudrais te poser une dernière question, avant de te remercier, qui est : Si nous devions lire un de tes articles, ouvrages, un ou plusieurs d'ailleurs, qu'est-ce que tu nous recommanderais?
Philippe 45:07
Alors, si c'est des articles, je vous recommanderais de lire plutôt ce que j'écris dans la presse grand public parce que les articles scientifiques des linguistes ne sont pas faits pour être lus par des gens qui sont pas préparés à ça. Après tout c'est normal, il y a quelqu'un qui fait un article en physique nucléaire, on s'attend pas à ce que n'importe qui puisse le lire. Donc moi, j'ai deux lieux principaux. C'est pas les seuls, mais j'ai deux lieux principaux d'écriture grand public sur les questions de langue et de société, parce que ça va avec, c'est donc un organe de presse, un média en ligne français très connu qui est Mediapart où je tiens un blog sur lequel je fais des commentaires de questions sociolinguistiques destinés aux lecteurs de Mediapart. Et aussi il y a un magazine international de valorisation sociale des sciences, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus dire vulgarisation parce que le terme a des mauvaises connotations, alors qui s'appelle en français, j'en suis désolé, The Conversation. Alors vous pouvez l'appeler Tes conversations, si vous voulez voilà. Alors, il y a une version en français à laquelle je contribue régulièrement sur des sujets voilà. Donc si c'est des articles, plutôt lire ça parce que mes articles sont presque tous en ligne sur une plateforme de chercheurs qui s'appelle Research Gate et vous pouvez aussi les trouver, ils sont en accès libre, simplement bon voilà, il faut s'y préparer un peu quoi. Bref et sinon lisez plutôt des livres parce que je trouve quand même qu'on parle de choses qui sont complexes, qu'on peut pas parler rapidement de choses complexes, on les simplifie trop, ça devient simpliste et donc je dirais alors sur ces questions-là plutôt mon ouvrage qui a eu beaucoup de succès, qui a fait connaître la notion de glottophobie qui s'appelle Discriminations : combattre la glottophobie qui est un ouvrage grand public mais qui quand même essaye de s'appuyer sur une démarche des fondements scientifiques parce que c'est quand même clairement le discours que j'essaye de tenir. Donc je vous conseillerais plutôt celui-là. Et puis sur la question des langues minoritaires, régionales, autochtones, etc., il se trouve, on en parlait en préparant cette émission, qu'il y a quelques jours à peine et paru un ouvrage que j'ai rédigé avec une historienne bretonne puisque je vis et je travaille en Bretagne, d'où mon intérêt aussi pour le breton et le gallo qui s'appelle Rozenn Milin, qui a d'ailleurs fait une thèse sur les méthodes employées pour humilier les enfants partout dans le monde pour les empêcher de parler leur langue, et ce bouquin s'appelle Langues régionales : idées fausses et vraies questions. C'est vraiment un livre très grand public pour combattre les croyances et les préjugés que les gens ont sur les langues, alors que vous vous appelleriez plutôt des langues autochtones au Canada, qu'en France on appelle, à tort d'ailleurs, des langues régionales. Mais vous voyez bien toutes ces langues que parlent depuis longtemps les gens qui vivent là et qu'on essaye d'empêcher de parler en méprisant leur langue et en les méprisant parce qu'ils les parlent. Ben voilà, c'est une réponse à ça, c'est des arguments pour répondre à ce mépris et à ces préjugés, à ces croyances.
Emmanuelle 48:16
Philippe merci. Beau projet pour nous. Tu nous laisses avec beaucoup de travail. Tu nous as parlé aujourd'hui d'interlinguistique, d'interculturel, de faire de la place aux langues, de donner la parole aux enfants, d'interdire les notes négatives. J'ai adoré ça. Tu nous as parlé de matrice pédagogique, de quoi encore...je suis en train de chercher, de langue régionale comme d'un terme inventé par l'état. Tu nous as parlé de langue européenne continentale, de langue exclue, d'apprentissage, de revernacularisation.
Philippe 48:53
Bravo!
Emmanuelle 48:54
...d'Astérix et d'Obélix et de potions magiques. Je pense que tu nous as donné un peu la formule magique pour transformer nos écoles en des lieux amis des langues, des lieux où les enfants ont envie d'aller, où les familles se sentent à nouveau parties prenantes de l'éducation de leurs enfants. Alors je veux vraiment te remercier pour tout ça et puis te souhaiter une bonne continuation et surtout un bon apéritif. Ça sera quoi ce soir?
Philippe 49:31
Et oui parce que c'est le soir ici en Bretagne. Alors ça sera comme toujours, pour le provençal que je suis, presque toujours un apéritif anisé mais sans alcool.
Emmanuelle 49:46
Un petit pastis sans alcool. Merci beaucoup et à la prochaine.
Philippe 49:52
Merci à vous deux. Merci beaucoup à Joey aussi parce que sans lui on n'aurait pas pu faire ça et merci pour le témoignage qu'il a eu la gentillesse de nous confier par ta bouche.
Emmanuelle 50:10
Merci! Au revoir Philippe.
Joey 50:13
Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux par courriel à crefo.oise@utoronto.ca